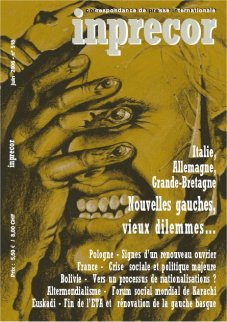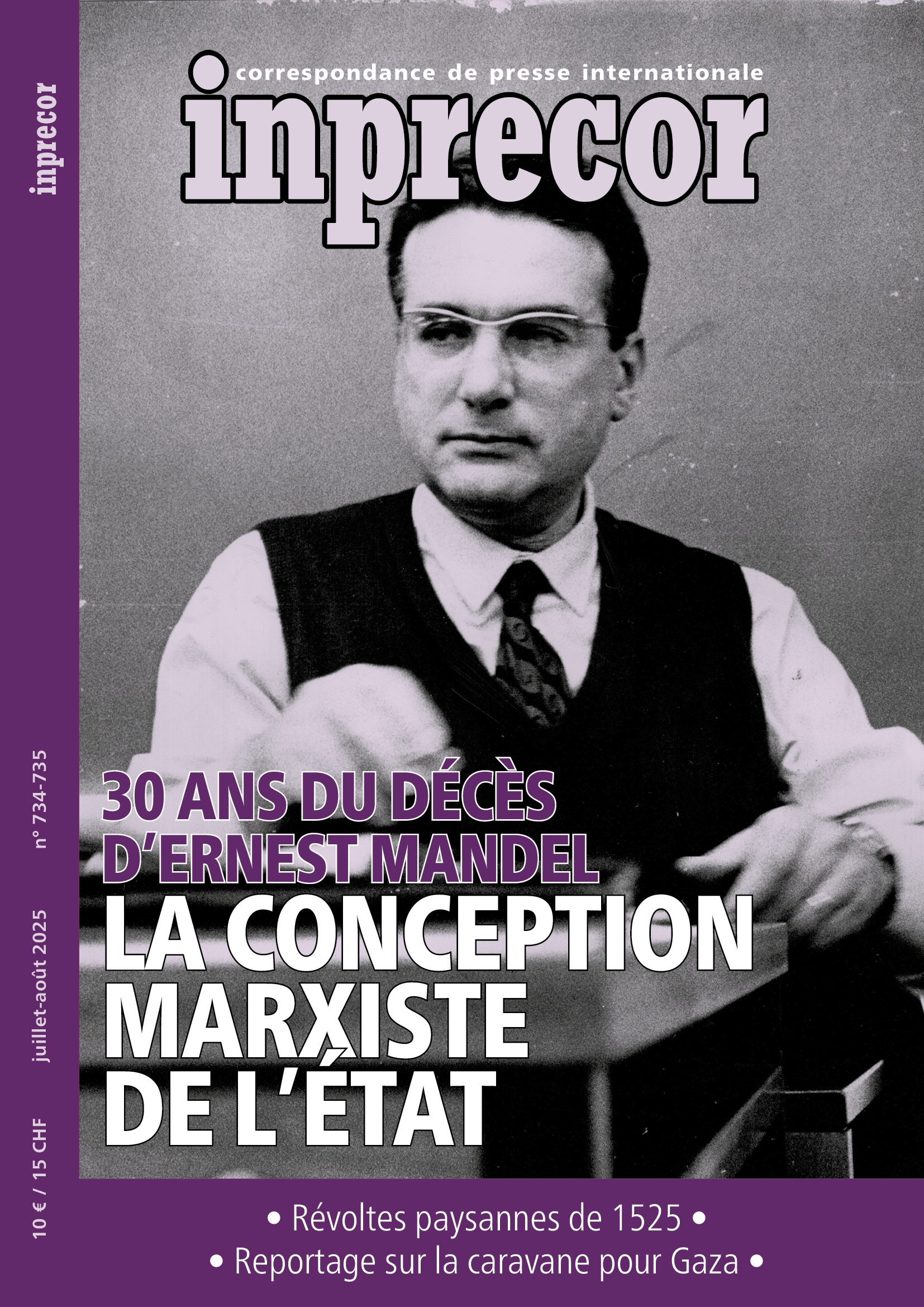Antoine Artous, Le fétichisme chez Marx - Le marxisme comme théorie critique, Éditions Syllepse, Paris 2006, 20 euros
Cette note ne se veut ni une présentation résumée du livre ni une liste exhaustive des problématiques abordées. Je voudrais juste pointer quelques éléments et très subjectivement, j'ai choisi certains passages en espérant qu'ils inspireront à la confrontation avec les thèses de ce beau livre et plus généralement avec ce qui est le sous-titre de l'œuvre majeure de Marx " Le Capital », à savoir la " Critique de l'économie politique ».
Au commencement l'analyse de la marchandise : " Il est difficile de comprendre le monde dans lequel nous vivons et la forme d'objectivité particulière du social qu'il porte si l'on ne commence pas par l'analyse de la marchandise qui n'est pas seulement un objet économique, mais une forme sociale structurant les relations entre individus ».
J'attire immédiatement l'attention sur les mots " objectivité » et " forme sociale » : les formes de représentation, les " idées » ne sont pas le simple reflet des rapports sociaux, mais un élément constitutif de l'objectivité du social ; la marchandise, le travail ne sont pas des catégories naturelles mais des constructions sociales. L'auteur y reviendra à de multiples reprises.
Signalons dès à présent que si les idées ne sont pas le simple reflet des rapports sociaux, si les formes d'opacité ne relèvent pas de la fausse " conscience » mais renvoient à des formes sociales objectives, non naturelles mais historiquement situées, des politiques révolutionnaires ne peuvent se réduire à une problématique de prise de conscience…
En partant du fétichisme de la marchandise " le fait qu'un rapport social des hommes entre eux se présente comme un rapport des choses entre elles ; en l'occurrence la valeur des marchandises, à travers laquelle s'organise l'échange, est socialement perçue comme leur attribut naturel, alors quelle est générée par des rapports de productions spécifiques », l'auteur présente une analyse critique des rapports sociaux capitalistes et des formes de socialisation des individus qu'ils structurent.
Il nous rappelle que le capitalisme n'est pas seulement marqué par le " désenchantement du monde », qu'il produit lui-même un nouvel enchantement : " les dieux sont morts, mais le monde est devenu peuplé de ces choses sensibles suprasensibles que sont les marchandises et leurs fantasmagories ».
La marchandise n'est pas une donnée transhistorique, elle est " la forme sociale du produit du travail dans les rapports de production capitalistes ». Les phénomènes de la double forme de la marchandise (valeur d'usage et valeur), le travail comme rapport social avec la distinction décisive entre travail et force de travail, sont présentés en regard du fonctionnement radicalement différent des sociétés antérieures.
Ne se cantonnant pas simplement au fétichisme de la marchandise, à la " chosification » des rapports sociaux, A. Artous analyse aussi " la personnification » des choses, le fétichisme issu de l'organisation capitaliste de la production, même " les moyens de productions, devenus capital, semblent produire de par eux-mêmes du profit ».
Revenant sur l'apport de Marx concernant la " subsomption (??) du travail sous le capital », en achetant la libre disposition de la force de travail, " le capitaliste instaure un rapport de soumission du travailleur afin de réaliser la valeur d'usage de la force de travail : la production de survaleur » ; il insiste sur le fait que la domination du capital dans la production n'est pas un pouvoir surajouté au progrès technique de production, mais " structure ce procès en même temps qu'il génère des formes de socialisation des individus. »
L'auteur explicite la différence entre la valeur-travail des économistes comme Ricardo et la théorie de la valeur de Marx, et pour poursuivre pose une question : " Par quelle procédure sociale objective, la société capitaliste est-elle capable de comparer des travaux différents, en les transformant en travail abstrait, c'est-à-dire en considérant le travail comme une substance homogène ? » lui permettant de polémiquer avec les théories de la réification et de la rationalité instrumentale.
Poursuivant ses travaux antérieurs, A. Artous revient sur la production des formes d'individualisation (sujet politico juridique et travailleur parcellaire).
Mais sans négliger les contradictions inscrites dans le fonctionnement du système " Le procès d'échange porte la liberté et l'égalité des échangistes comme présupposé théorique, en quelque sorte, mais le droit égal et l'égalité citoyenne comme forme politico juridique n'est pas une donnée naturelle du système », dans ce cadre l'État occupe une fonction particulière dans la construction du rapport salarial.
Dans cette partie aussi, A. Artous revient sur la différence fondamentale avec les sociétés précapitalistes (domination directe des individus, rapports de dépendances personnelles) et sur les acquêts du capitalisme (dissolution des formes communautaires d'existence des individus, désencastrement des rapports de production capitalistes, particularisation de l'homme). Il analyse de plus les rapports entre État, droit et luttes de classe.
Puis l'auteur ouvre des questionnements sur fétichisme et communisme en traitant notamment des dictatures staliniennes sous un angle particulier : " Le fétichisme de l'État-plan fonctionne comme un fétichisme de l'organisation administrative des relations sociales »
Il nous incite à réfléchir sur les conséquences de la révolution radicale instruite par le capitalisme et à " prendre en compte une série de séparations introduites dans l'organisation de l'espace social par le capitalisme et non rêver de réunifier la vie sociale autour de la figure du producteur »
Contre une certaine tradition marxiste, ces analyses renouent avec les riches débats des années 1920, repris dans les années 1970 avec la levée de la chape de plomb du stalinisme. L'auteur nous rappelle que ce qui est premier pour Marx ce n'est pas l'activité économique, c'est la façon dont les hommes produisent et organisent leurs rapports sociaux.
Les chapitres sont assortis de commentaires, dialogues critiques avec de multiples auteurs marxistes ou non.
A l'heure de la marchandisation du monde, voilà un ouvrage bienvenu qui mérite l'attention et l'étude.
Je voudrais terminer cette note par un commentaire plus personnel.
Tout en ayant lu les principaux auteurs cités et republiés dans les années 1970 (entre autres Jakubowsky, Pasukanis et Roubine, sans compter la place particulière des écrits du jeune Lukacs), mes réflexions ont souvent été dominées par les représentants du " courant chaud » de la critique radicale (tel Ernst Bloch, Walter Benjamin, T. Adorno, M. Horkheimer, H. Marcuse, ou Lucien Goldman pour n'en citer que quelques-uns) car ils répondaient mieux à mes yeux à l'horreur du monde (qu'elle fut quotidienne ou historique comme le fascisme et le stalinisme).
La rigueur inscrite dès le premier livre d'A. Artous " Marx, l'État et la politique » m'a permis de renouer avec une approche moins " morale » et plus radicale de l'analyse du capitalisme (rapports sociaux spécifiques, acquêts de la révolution capitaliste, etc.). La critique de l'économie politique reste indispensable pour appréhender la complexité du monde dans ses multiples dimensions. Loin des réductions économistes et des simplifications sociologiques, elle reste centrale pour asseoir des élaborations pour des politiques alternatives radicales vraiment émancipatrices pour toutes et tous. ■