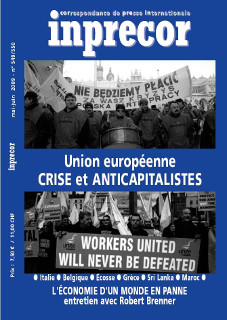Seongjin Jeong : La plupart des médias et des analystes présentent l'actuelle crise comme une " crise financière ». Êtes-vous d'accord avec cette caractérisation ?
Robert Brenner : Il est compréhensible que les analystes de la crise aient pris pour point de départ l'effondrement du marché des banques et assurances. Le problème c'est qu'ils n'ont pas été plus loin. Depuis le Secrétaire du Trésor Henry Paulson et le chef de la Réserve Fédérale Ben Bernanke jusqu'aux moins haut placés, ils disent que la crise peut être expliquée simplement par les problèmes du secteur financier. Et en même temps ils affirment que l'économie réelle est forte, que les soi-disant fondamentaux sont en bonne forme. Ceci est totalement erroné.
La source fondamentale de la crise actuelle c'est le déclin de la vitalité des économies avancées depuis 1973 et, tout particulièrement, depuis 2000. Cycle économique après cycle économique leurs résultats se sont fortement détériorés aux États-Unis, en Europe occidentale, au Japon. Cela apparaît dans tous les indices macro-économiques : le PNB, les investissements, les salaires réels et ainsi de suite. Le cycle économique qui vient tout juste de se conclure, de 2001 à 2007, a été — de loin — le plus mauvais depuis la seconde guerre mondiale et ceci malgré le recours au plus grand stimulateur économique sponsorisé par le gouvernement de toute histoire des États-Unis en temps de paix.
Seongjin Jeong : Comment expliquez-vous cet affaiblissement de l'économie réelle depuis 1973, que vous nommez dans votre livre " le long déclin » ?
Robert Brenner : Pour l'essentiel ce qui permet de l'expliquer c'est un profond et durable déclin du taux de rentabilité sur l'investissement du capital depuis la fin de la décennie 1960. L'incapacité de récupérer le taux de profit est d'autant plus remarquable qu'au cours de toute cette période nous avons assisté à une très forte réduction de la croissance des salaires réels.
La cause principale — mais pas unique — de ce déclin du taux de profit a été la tendance persistante à la surcapacité des industries manufacturières mondiales. Nous avons assisté à l'entrée sur le marché mondial de nouvelles puissances industrielles, l'une après l'autre : l'Allemagne et le Japon, les pays de l'Asie du Nord-Est nouvellement industrialisés, les tigres de l'Asie du Sud-Est et, finalement, le Léviathan chinois. Ces économies développées tardivement produisent les mêmes marchandises que les économies développées auparavant, seulement moins chères. Le résultat c'est une offre dépassant la demande dans un secteur après l'autre, imposant la baisse des prix et de cette manière la baisse des profits. Face à la compression de leurs bénéfices les entreprises n'ont pas délaissé leurs industries ; elles ont tenté de se maintenir en employant leurs capacités d'innovation et en investissant dans de nouvelles technologies. Mais naturellement cela n'a fait qu'empirer leurs surcapacités.
En raison de la chute de leur taux de rentabilité les capitalistes obtenaient des excédents de plus en plus faibles de leurs investissements. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de ralentir la croissance des usines, des équipements et de l'emploi. En même temps, afin de reconstituer la rentabilité, ils ont pressionné les salaires des employés au moment même où le gouvernement réduisait la croissance des dépenses sociales.
La conséquence de toutes ces réductions des dépenses c'est un problème à long terme de la demande globale. La faiblesse persistante de cette dernière a été la source immédiate de la faiblesse durable de l'économie.
Seongjin Jeong : La crise actuelle a débuté par l'éclatement de la bulle immobilière, qui avait gonflé durant toute la décennie. Quelle est, selon vous, son importance ?
Robert Brenner : La bulle immobilière doit être interprétée en relation avec la succession des bulles boursières que l'économie a connue depuis le milieu des années 1990 et en tenant compte tout particulièrement du rôle de la Réserve Fédérale des États-Unis dans leur gonflement.
Depuis le début du long déclin les autorités économiques de l'État ont essayé de faire face au problème de l'insuffisance de la demande en encourageant la croissance des emprunts, publics et privés. Tout d'abord elles ont utilisé le déficit budgétaire de l'État, évitant de cette manière des récessions très profondes. Mais avec le temps les mêmes emprunts souscrits par l'État produisaient de moins en moins de croissance. En effet, afin de conjurer les profondes crises qui ont historiquement été la plaie du système capitaliste, les autorités ont dû accepter le glissement vers la stagnation.
Au début des années 1990, les gouvernements des États-Unis et de l'Europe, menés par l'administration Clinton, ont tenté de rompre avec leur penchant vers l'endettement en s'orientant vers des budgets équilibrés. L'idée était de laisser le marché libre régir l'économie. Mais étant donné que la rentabilité n'avait toujours pas été récupérée, la réduction des déficits a provoqué encore une réduction de la demande, contribuant à provoquer les récessions et à affaiblir la croissance entre 1991 et 1995.
Pour retrouver l'expansion économique les autorités états-uniennes ont fait le choix de se tourner vers une politique qui avait été d'abord expérimentée par le Japon à la fin de la décennie 1980. En maintenant bas le taux d'intérêt, la Réserve Fédérale a facilité l'endettement afin d'encourager l'investissement financier. Alors que les prix des actions montaient les entreprises et les ménages aisés ont connu un fort accroissement de leur richesse, au moins sur le papier. Ils pouvaient donc emprunter sur une très grande échelle, augmentant considérablement leurs investissements et leur consommation, entraînant ainsi l'économie.
Les déficits privés ont ainsi remplacé les déficits publics. Ce qu'on pourrait nommer " le keynésianisme boursier » a remplacé le keynésianisme traditionnel. Au cours de la dernière douzaine d'années nous avons ainsi été les témoins de l'extraordinaire spectacle d'une économie mondiale dans laquelle l'accumulation du capital est devenue littéralement dépendante des vagues historiques de la spéculation, soigneusement consolidées et rationnalisées par les décideurs politiques — et par les régulateurs ! — des États : d'abord la première bulle historique du marché boursier à la fin des années 1990, puis la bulle immobilière et la bulle du crédit au début des années 2000.
Seongjin Jeong : En prévoyant la crise actuelle, aussi bien que celle de 2001, vous avez joué le rôle d'un prophète. Quelles perspectives prévoyez-vous pour l'économie mondiale ? Va-t-elle empirer ou récupérera-t-elle avant la fin 2009 ? Croyez-vous que la crise actuelle sera aussi sévère que l'a été la Grande Dépression ?
Robert Brenner : La crise actuelle est la plus sérieuse des récessions de l'après-guerre, pire que celle de 1979-1982. Elle pourrait peut-être rivaliser avec la Grande Dépression, mais il n'y a aucune manière de le savoir vraiment. Les prévisionnistes économiques ont sous-estimé sa gravité car ils ont surestimé la force de l'économie réelle ne prenant pas en compte l'ampleur de la dépendance de cette dernière envers l'endettement, qui est fondé sur des bulles du prix des actions.
Aux États-Unis, au cours du récent cycle économique 2001-2007, la croissance du PIB a été la plus faible depuis la seconde guerre mondiale. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'emploi dans le secteur privé. Les investissements dans les entreprises et les équipements ont été de près d'un tiers plus bas que dans le plus mauvais cycle depuis la guerre. Les salaires réels ont été fondamentalement plats. Pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale il n'y a pas eu d'augmentation du revenu familial médian. La croissance a été tirée, pour l'essentiel, par la consommation personnelle et les investissements immobiliers, rendus possibles du fait du crédit facile et de la hausse des prix immobiliers.
Les performances économiques furent très faibles malgré l'énorme stimulation par la bulle immobilière et le déficit budgétaire titanesque de l'administration Bush. Au cours des années 2001-2005 l'immobilier comptait à lui seul pour un tiers de la croissance et pour près de la moitié de la création des emplois. Il était donc prévisible que, lorsque la bulle immobilière éclaterait, la consommation et les investissements résidentiels allaient s'effondrer et que l'économie plongerait.
Seongjin Jeong : Nombreux sont ceux qui affirment que la crise actuelle est une crise financière typique et non une crise " marxienne » de surproduction et de chute du taux de profit, disant que c'est la spéculation financière, la bulle et son éclatement qui ont joué le rôle central. Que leur répondriez-vous ?
Robert Brenner : Je ne crois pas qu'il soit utile d'opposer de cette manière les aspects réels et financiers de la crise. Comme je l'ai souligné, c'est une crise " marxienne » parce qu'elle plonge ses racines dans la baisse à long terme du taux de profit et son incapacité de récupérer. C'est la source essentielle du ralentissement prolongé de l'accumulation du capital jusqu'à maintenant. En 2001 le taux de profit des sociétés états-uniennes non financières a été le plus bas de la période de l'après-guerre, à l'exception de l'année 1980. Les entreprises n'ont donc pas d'autre choix que de réduire l'investissement et l'emploi en aggravant encore le climat économique.
C'est cela qui explique la très faible croissance au cours du cycle économique qui vient de s'achever. Néanmoins, pour comprendre la chute actuelle vous devez démontrer la connexion entre la faiblesse de l'économie réelle et l'effondrement financier. Le lien principal, c'est la dépendance sans cesse plus grande de l'économie à l'égard du crédit et l'engagement toujours plus grand des gouvernements dans le maintien des cours de la Bourse pour permettre à l'endettement de continuer.
La condition pour l'apparition des bulles immobilière et du marché du crédit était le maintien des bas coûts de l'emprunt. La faiblesse de l'économie mondiale, en particulier après les crises de 1997-1998 et de 2001-2002, et les énormes achats de dollars par les gouvernements de l'Asie de l'Est (pour garantir la faiblesse de leurs monnaies et la croissance de la consommation aux États-Unis) ont maintenu les taux d'intérêt à long terme exceptionnellement bas durant une période inhabituellement longue. En même temps la Réserve Fédérale des États-Unis a maintenu les taux d'intérêt à court terme plus bas qu'à tout moment depuis 1950. Pouvant emprunter à si bas prix, les banques étaient disposées à prolonger les crédits aux spéculateurs, dont les investissements ont fait grimper le prix des actions de toute sorte toujours plus haut alors que le coût du crédit continuait à se réduire.
De manière symptomatique les prix de l'immobilier ont monté alors que le rendement en termes réels des bons du Trésor états-unien plongeait. Mais comme les taux continuaient à baisser, les établissements à travers le monde qui dépendaient du taux d'intérêt avaient de plus en plus de mal à réaliser des bénéfices suffisants. Les fonds de pensions et les compagnies d'assurances ont été particulièrement atteints, mais également les fonds spéculatifs et les banques d'affaires.
Ces établissements étaient donc tout prêts à effectuer des investissements massifs dans des titres soutenus par l'hypothèque fortement douteuse des subprimes, à cause du rendement incroyablement élevé qu'elles offraient, ignorant le risque exceptionnellement élevé. En fait ils n'arrivaient pas à en obtenir autant qu'ils auraient voulu. Leurs achats des valeurs hypothécaires ont permis aux créateurs de ces valeurs de continuer à créditer même les emprunteurs les moins fiables. La bulle immobilière a ainsi atteint des proportions historiques et l'expansion économique pouvait continuer.
Naturellement cela ne pouvait pas durer. Lorsque les prix de l'immobilier ont baissé l'économie réelle est entrée en récession et le secteur financier a connu un effondrement car le dynamisme des deux dépendait de la bulle immobilière. Aujourd'hui la récession aggrave l'effondrement financier car elle exacerbe la crise immobilière. Et l'effondrement financier intensifie la récession car il rend très difficile l'accès au crédit. Cette interaction entre la crise de l'économie réelle et celle du secteur financier, qui s'aggravent mutuellement, a rendu la pente très glissante, très difficile à gérer pour les décideurs et le potentiel de la catastrophe tout à fait évident.
Seongjin Jeong : Même si l'on admet que le capitalisme de l'après-guerre est entré dans une période de déclin au cours des années 1970, il semble indéniable que l'offensive capitaliste néolibérale a empêché la détérioration de ce déclin depuis les années 1980.
Robert Brenner : Si par néolibéralisme vous entendez la financiarisation et la déréglementation, je ne vois pas en quoi il a aidé l'économie. Mais si vous voulez parler de l'assaut conduit par les employeurs et les gouvernements contre les salaires des travailleurs, les conditions du travail et l'État providence, il n'y a pas de doutes qu'il a ralenti la chute du taux de profit.
Néanmoins l'offensive des employeurs n'a pas attendu jusqu'à la soi-disant ère néolibérale des années 1980. Elle a commencé dès la chute des profits, au début des années 1970, en pleine ère du keynésianisme. Par ailleurs elle n'a pas eu pour résultat le rétablissement du taux de profit et a seulement exacerbé le problème de la demande solvable. L'affaiblissement continu de cette dernière a finalement poussé les autorités économiques à chercher un stimulant économique beaucoup plus puissant et plus dangereux, le " keynésianisme boursier » qui a conduit au désastre actuel.
Seongjin Jeong : Certains ont avancé que le nouveau paradigme de " financiarisation » ou de " capitalisme financier » a soutenu le soi-disant " Capital résurgent » (Gérard Duménil) entre les années 1980 et maintenant. Que pensez vous d'une telle thèse ?
Robert Brenner : L'idée d'un capitalisme dirigé par la finance est une contradiction terme à terme, parce que, pour parler généralement — il y a des exceptions significatives, tel le crédit de consommation — le soutien financier de la réalisation du profit dépend du soutien de la réalisation du profit dans l'économie réelle. Pour répondre à baisse du taux de profit dans l'économie réelle certains gouvernements, conduits par les États-Unis, ont encouragé un tournant financier en déréglementant le secteur financier. Mais comme l'économie réelle a continué à languir, le résultat principal de la déréglementation a été l'intensification de la concurrence dans le secteur financier qui a rendu plus difficile la réalisation du profit et a encouragé une spéculation de plus en plus grande et la prise des risques.
Les dirigeants des banques d'affaires et des fonds spéculatifs ont pu faire des fortunes fabuleuses car leurs revenus dépendaient des bénéfices à court terme. Ils pouvaient garantir temporairement des rendements très élevés en augmentant les actions et emprunts de leurs firmes et en augmentant le risque. Mais cette manière de réaliser des affaires c'est faite, tôt ou tard, aux dépens de la santé financière de leurs propres entreprises à long terme, dont le résultat le plus spectaculaire a été la faillite des principales banques d'affaires de Wall Street.
Toute expansion soit-disant financière depuis 1970 a très rapidement fini dans une crise financière désastreuse et a nécessité un renflouement massif par l'État. Ce fut le cas du boom créditeur du tiers-monde dans les années 1970 et au début des années 1980 ; de la bulle boursière de la seconde moitié des années 1990 ; et naturellement des bulles immobilières et créditrices des années 2000. Le secteur financier a semblé dynamique seulement parce que les gouvernements étaient disposés à tout faire pour le soutenir.
Seongjin Jeong : Le keynésianisme ou l'étatisme semble resurgir comme un nouvel " esprit de l'époque ». Quelle est votre évaluation générale de ce keynésianisme ou étatisme résurgent ? Peut-il aider à résoudre ou du moins alléger la crise actuelle ?
Robert Brenner : Aujourd'hui les gouvernements n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers le keynésianisme et l'État pour tenter de sauver l'économie. Après tout, le marché libre s'est montré complètement incapable de prévenir la catastrophe économique ou d'y faire face et encore moins de garantir la stabilité et la croissance. C'est pour cela que les élites politiques mondiales, qui hier encore célébraient les marchés financiers déréglementés, sont soudainement tous devenus keynésiennes.
Mais il y a des raisons pour douter que le keynésianisme, compris comme des déficits publics énormes et le crédit facile en vue de gonfler la demande, pourrait avoir l'impact que beaucoup espèrent. Après tout, au cours des sept années passées, grâce aux emprunts et aux dépenses encouragées par la bulle immobilière de la Réserve Fédérale et les déficits budgétaires de l'administration Bush, nous avons été les témoins du plus grand stimulant économique keynésien de l'histoire du temps de paix. Pourtant le résultat a été le plus faible cycle économique de l'après-guerre.
Aujourd'hui le défi est beaucoup plus grand. Alors que la bulle immobilière s'effondre et que le crédit devient de plus en plus difficile à obtenir, les ménages réduisent leur consommation et leurs investissements résidentiels. Par conséquence les entreprises voient leurs profits décliner. Elles réduisent donc encore les salaires et licencient les salariés plus rapidement, ce qui accélère la spirale du déclin de la demande et de la chute des profits.
Les ménages ont pendant longtemps espéré que la hausse du prix des logements leur permettra d'emprunter plus (1) et de faire ainsi des économies. Mais maintenant, à cause de l'augmentation de l'endettement, ils devront réduire leurs emprunts et accroître leurs réserves au moment même où l'économie a le plus besoin qu'ils consomment. Nous pouvons donc penser que la plus grande partie de l'argent que le gouvernement fournit aux ménages sera économisée et non dépensée. Et comme le keynésianisme a pu à peine faire bouger l'économie au cours de l'expansion, que pouvons-nous attendre de lui au cours de la plus grande récession depuis les années 1930 ?
Pour obtenir un résultat significatif sur la situation économique l'administration Obama devrait sans doute réaliser une énorme vague d'investissements gouvernementaux, directs et indirects, c'est-à-dire recourir à une forme de capitalisme d'État. Pour le faire actuellement il faudrait surmonter de très grands obstacles politiques et économiques.
La culture politique des États-Unis est très hostile à l'entreprise publique. En même temps le niveau des dépenses et de l'endettement de l'État qu'une telle orientation exigerait pourrait menacer le dollar. Jusqu'à maintenant les gouvernements de l'Asie de l'Est ont été heureux de financer les déficits extérieurs et intérieurs des États-Unis, pour soutenir ainsi la consommation états-unienne et leur propre export. Mais avec la crise qui atteint même la Chine, ces gouvernements peuvent perdre leur capacité de financer les déficits états-uniens, surtout si ces derniers atteignent une taille sans précédents. La perspective terrifiante d'un effondrement du dollar apparaît à l'arrière-plan.
Seongjin Jeong : Quelle est votre évaluation de la victoire d'Obama lors de la dernière élection présidentielle ? Nombreux sont ceux qui considèrent Obama comme le F.D. Roosevelt du XXIe siècle, qui pourrait apporter un nouveau " New Deal ». Pensez-vous que les progressistes anticapitalistes pourraient soutenir de manière critique certaines de ses politiques ?
Robert Brenner : Le triomphe électoral d'Obama doit être bien accueilli. La victoire de McCain aurait été une victoire du Parti républicain et aurait renforcé les forces les plus réactionnaires sur la scène politique des États-Unis. Elle aurait été perçue comme l'approbation de l'hypermilitarisme et de l'impérialisme de l'administration Bush ainsi que de son projet explicite d'élimination de la gauche des syndicats, de l'État providence et de la protection de l'environnement.
Ceci dit, Obama est, comme Roosevelt, un Démocrate centriste dont on ne peut attendre qu'il fera grand chose pour défendre les intérêts de la grande majorité des travailleurs soumis à l'assaut des entreprises tentant de compenser l'effondrement de leurs profits en réduisant l'emploi, les acquis etc.
Obama a soutenu le renflouement titanesque du secteur financier qui représente peut-être le plus grand vol du contribuable de toute l'histoire des États-Unis et qui, de plus, a été réalisé sans contreparties de la part des banques. Il a également soutenu le renflouement de l'industrie automobile alors même que celui-ci est conditionné par des coupes massives dans les acquis des travailleurs de l'automobile.
Le résultat c'est que, comme de Roosevelt, on ne peut espérer d'Obama qu'il prendra des mesures décisives en défense des travailleurs que s'il y est poussé par l'action directe organisée d'en bas. L'administration Roosevelt n'a pu faire passer les lois les plus progressistes du " New Deal », dont le Wagner Act (2) et la loi sur la Sécurité sociale, que sous la pression de la grande vague de grèves de masse. Nous pouvons attendre la même chose d'Obama.
Seongjin Jeong : Selon Rosa Luxembourg, et plus récemment David Harvey, le capitalisme surmonte sa tendance à la crise par l'expansion géographique. Selon lui ceci est souvent facilité par des investissements étatiques massifs dans l'infrastructure en vue de soutenir l'investissement des capitaux privés, souvent des investissements étrangers directs. Pensez-vous que le capitalisme peut trouver une telle sortie de la crise actuelle, pour employer la terminologie de Harvey, par la voie d'une conquête " temporo-spatiale » ?
Robert Brenner : C'est un problème complexe. Tout d'abord, je pense qu'il est vrai de dire que l'expansion géographique a été essentielle pour toute grande onde de l'accumulation du capital. Cela est très important pour l'analyse critique. On pourrait dire que l'accroissement de la force du travail et de l'espace géographique du système sont les bases de la croissance capitaliste. Le boom de l'après-guerre en est un bon exemple avec les expansions spectaculaires du capital dans le Sud et le Sud-Ouest des États-Unis, en Europe occidentale et au Japon, déchirés par la guerre.
A cette époque les investissements des entreprises états-uniennes ont joué un rôle critique non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe occidentale. Sans aucun doute cette expansion de la force du travail et de l'aire géographique du capitalisme était indispensable pour garantir le taux de profit élevé qui a rendu le boom de l'après-guerre si dynamique. Du point de vue marxiste, c'était une onde classique d'accumulation capitaliste et, nécessairement, elle a dû aspirer des masses énormes du travail de l'extérieur du système, en particulier des campagnes précapitalistes de l'Allemagne et du Japon, ainsi que l'incorporation ou la réincorporation d'un espace géographique additionnel sur une large échelle.
Néanmoins, je pense que le modèle du long déclin depuis la fin des années 1960 et le début des années 1970 a été différent. Il est vrai que le capital a répondu à la baisse de sa rentabilité par davantage d'expansion extérieure, cherchant à combiner les techniques avancées avec la main-d'œuvre à prix réduit. L'Asie de l'Est constitue incontestablement le cas essentiel et un moment historique mondial, une transformation fondamentale pour le capitalisme.
Pourtant, bien que l'expansion en Asie de l'Est ait représenté une réponse à la baisse de la rentabilité, je pense qu'elle n'a pas constitué une solution satisfaisante. Car finalement la nouvelle production manufacturière a émergé de manière spectaculaire en Asie de l'Est, en grande partie reproduisant la fabrication qui avait déjà lieu ailleurs, mais à un prix plus bas. A l'échelle du système cela a aggravé au lieu de résoudre le problème de la surcapacité de production.
En d'autres termes la mondialisation a été une réponse à la chute de la rentabilité mais du fait que ces nouvelles industries ne sont pas fondamentalement complémentaires du point de vue de la division mondiale du travail, qu'elles sont au contraire redondantes, le problème de la rentabilité continue.
Pour résoudre actuellement le problème de la rentabilité qui l'a si longtemps infesté — en ralentissant l'accumulation du capital et en imposant des niveaux sans cesse plus élevés de l'endettement pour soutenir sa stabilité — le système exige la crise qui fut si longtemps remise à plus tard. Puisque le problème c'est la surcapacité de production, exacerbée de manière massive par l'explosion de l'endettement, ce qu'exige encore le système capitaliste c'est, comme dans la vision classique, l'expulsion du système des entreprises dont la production est trop coûteuse et dont les profits sont trop bas, permettant en conséquence la réduction des prix des moyens de production et celle de la force du travail.
Historiquement, c'est à travers la crise que le capitalisme a pu rétablir le taux de profit et donc les conditions pour une accumulation plus dynamique du capital. Durant la période de l'après-guerre, la crise a été écartée mais au prix du non rétablissement de la rentabilité ce qui a conduit à une stagnation aggravée. La crise actuelle exige cette expulsion qui ne s'est jamais produite.
Seongjin Jeong : Ainsi vous pensez que seule la crise peut résoudre la crise ? C'est une réponse marxienne classique.
Robert Brenner : Je crois que tel est probablement le cas. On peut prendre une analogie. D'abord, au début des années 1930, le " New Deal » et le keynésianisme s'avéraient inefficaces. En fait au cours des années 1930 les conditions d'un nouveau boom n'étaient pas réunies ce qui fut démontré lorsque l'économie a connu de nouveau une grave dépression en 1937-1938. Mais finalement, en tant que résultat de la longue crise des années 1930, les biens de production coûteux et peu rentables ont été détruits créant ainsi les conditions pour une hausse du taux de profit.
Vers la fin des années 1930 on peut dire que le taux de profit potentiel était haut et que ce qui manquait était un choc qui accroisse la demande. Bien sûr, la demande est venue des dépenses d'armement massives au cours de la seconde guerre mondiale. Ainsi la guerre a produit l'augmentation du taux de profit et ces profits élevés ont créé les conditions nécessaires pour le boom de l'après-guerre. Mais je ne crois pas que les déficits keynésiens auraient fonctionné même s'ils avaient été essayés en 1933, car en 1933 il manquait encore ce qu'on appelle en termes marxiens une crise nettoyante du système capitaliste.
Seongjin Jeong : Pensez-vous que la crise actuelle va mettre en défi l'hégémonie des États-Unis ? Les théoriciens du système-monde, comme Immanuel Wallerstein, qui a été également interviewé par Hankyoreh, disent que l'hégémonie de l'impérialisme états-unien est en déclin.
Robert Brenner : C'est encore une question très complexe. Je peux me tromper, mais il me semble que beaucoup de ceux qui croient qu'il y a eu un déclin de l'hégémonie des États-Unis l'envisagent essentiellement comme une expression du pouvoir géopolitique des États-Unis, c'est-à-dire en fin de comptes de la force. D'un tel point de vue c'est principalement la domination des États-Unis qui garantit leur leadership, c'est le pouvoir des États-Unis sur et contre les autres pays qui les met au sommet.
Je ne vois pas l'hégémonie des États-Unis de cette manière. Je vois les élites mondiales, en particulier les élites du noyau capitaliste au sens large, satisfaites de l'hégémonie états-unienne car cela signifie pour eux que les États-Unis assument le rôle et le coût du policier mondial. Je pense que cela est vrai aujourd'hui même en ce qui concerne les élites des pays les plus pauvres.
Quel est le rôle des États-Unis en tant que policier mondial ? Ce n'est pas d'attaquer les autres pays, c'est surtout de préserver l'ordre social, de créer les conditions stables pour l'accumulation capitaliste mondiale. Son but principal c'est d'éliminer tous les défis populaires au capitalisme, de soutenir les structures existantes des rapports entre les classes.
Au cours de la majeure partie de la période de l'après-guerre il y avait des défis nationalistes-étatiques au libre règne du capital, qui venaient surtout d'en bas. Ils ont incontestablement dû faire face à la force la plus brutale des États-Unis, à l'expression nue de leur domination. Bien qu'au sein du noyau du système il y avait l'hégémonie états-unienne (3), à l'extérieur la domination s'exerçait par la violence.
Mais avec la chute de l'Union soviétique, l'engagement de la Chine et du Vietnam sur la voie capitaliste, la défaite des mouvements de libération nationale en Afrique australe et en Amérique centrale, la résistance au capital dans le monde développé a été très affaiblie, au moins pour l'instant. Donc actuellement les gouvernements et les élites non seulement de l'Europe occidentale et orientale, du Japon et de Corée, mais aussi du Brésil, de l'Inde et de la Chine — de la plupart des pays que vous pourrez nommer — préfèrent que l'hégémonie des États-Unis se poursuive.
Elle ne sera pas remise en cause par le développement d'une autre puissance capable de contester leur domination mondiale. Avant tout, la Chine préfère l'hégémonie états-unienne. Les États-Unis ne prévoient pas d'attaquer la Chine et, jusqu'à maintenant, ils ont maintenu leur marché ouvert aux exportations chinoises. Avec le policier états-unien du monde garantissant toujours le libre échange et les mouvements de capitaux la Chine a pu prendre part à la concurrence des coûts de production, sur un terrain de jeu égal, et cela lui a été incroyablement profitable— cela ne pourrait être mieux.
Est-ce que l'hégémonie des États-Unis pourra perdurer au cours de la crise actuelle ? C'est une question beaucoup plus difficile. Mais je pense que, à première vue, la réponse est oui. Les élites mondiales aspirent surtout à la préservation de l'actuel ordre mondial et les États-Unis sont essentiels pour cela. Aucune des élites du monde n'essaye d'exploiter la crise ou les énormes problèmes économiques des États-Unis pour contester cette hégémonie.
La Chine continue à dire " nous n'allons pas continuer à payer pour que les États-Unis poursuivent leurs manières éhontées », en se référant à la façon dont la Chine a couvert les déficits record de la balance des payements des États-Unis au cours de la décennie passée ainsi que le déficit budgétaire titanesque créé maintenant. La Chine va-t-elle couper le robinet aux États-Unis ? Pas du tout. La Chine verse toujours autant d'argent qu'elle peut pour tenter de maintenir l'économie américaine de manière à pouvoir continuer à se développer de la manière qu'elle a choisie.
Bien sur, ce qui est désiré n'est pas toujours possible. La crise chinoise peut devenir si grave qu'elle ne pourra plus financer les déficits états-uniens ; l'aggravation de ces déficits et le recours à la planche à billets par la Réserve Fédérale peuvent conduire à l'effondrement du dollar, mettant le feu à la véritable catastrophe.
Si de telles choses se produisaient, il serait nécessaire de construire un ordre nouveau. Mais dans les conditions d'une crise profonde ce serait très difficile. En effet, dans de telles conditions les États-Unis aussi bien que les autres États pourraient aisément se tourner vers le protectionnisme économique, le nationalisme et même vers la guerre. Je pense que, pour le moment, les élites du monde tentent toujours d'éviter cela — elles ne sont pas prêtes. Ce qu'elles veulent, c'est de maintenir les marchés ouverts et le commerce libre.
Elles savent que la dernière fois que les États ont eu recours au protectionnisme pour résoudre le problème, lors de la Grande dépression, cela a aggravé la dépression, parce que quand quelques États ont entrepris de se protéger, les autres ont suivi et le marché mondial s'est fermé. Après, naturellement, sont venus le militarisme et la guerre. La fermeture du marché mondial serait évidemment un désastre aujourd'hui et c'est pour cela que les élites et les gouvernements font leur possible pour empêcher une issue protectionniste, étatiste, nationaliste et militariste.
Mais la politique n'est pas uniquement l'expression des souhaits des élites et les souhaits des élites changent avec le temps. D'ailleurs, elles sont en général divisées et la politique dispose d'une autonomie. Ainsi, par exemple, on ne peut exclure que si la crise s'aggrave — ce qui ne serait pas une grande surprise — on verra un retour de la politique d'extrême droite fondée sur le protectionnisme, le militarisme, le nationalisme et la chasse aux immigrés.
Une telle politique pourrait non seulement bénéficier d'une large popularité. Des secteurs croissants du capital pourraient y voir la seule sortie devant l'effondrement de leurs marchés et la dépression du système, espérant obtenir ainsi une protection contre la concurrence, des subventions étatiques et le développement de la demande à travers les dépenses militaires. Ce fut la réponse qui a prévalu en grande partie en Europe et au Japon durant la crise de l'entre-deux guerres. Aujourd'hui la droite est dans ses petits souliers du fait de la faillite de Bush et du fait de la crise. Mais si l'administration Obama s'avère incapable de parer à l'effondrement économique, la droite pourrait aisément revenir… particulièrement parce que les Démocrates n'offrent aucune alternative idéologique.
Seongjin Jeong : Vous avez mentionné la potentielle crise chinoise. Que pensez-vous de l'état actuel de l'économie chinoise ?
Robert Brenner : Je pense que la crise chinoise sera beaucoup plus grave que ce que les gens imaginent et cela pour deux raisons essentielles.
Premièrement, parce que la crise américaine — et plus généralement la crise mondiale — est bien plus sérieuse que ce que les gens attendaient et qu'en dernière analyse le destin de l'économie chinoise dépend inextricablement du destin des États-Unis et de l'économie mondiale : non seulement parce que la Chine est très dépendante des exportations vers le marché états-unien mais parce que la majeure partie du reste du monde est aussi très dépendante des États-Unis et cela inclut en particulier l'Europe.
Si je ne me trompe pas, l'Europe est récemment devenue le principal marché des exportations chinoises. Mais comme la crise provenant des États-Unis tire aussi l'Europe vers le bas, le marché européen se contractera également pour les marchandises chinoises. La situation de la Chine est donc plus difficile que prévu, car la crise économique est plus grave que prévu.
Deuxièmement, dans l'enthousiasme suscité par la croissance économique réellement spectaculaire de la Chine, beaucoup de gens ont ignoré le rôle des bulles qui ont tiré l'économie chinoise. La Chine s'est développée essentiellement par les exportations, en particulier du fait de l'accroissement de l'excédent de sa balance commerciale avec les États-Unis. A cause de cet excédent le gouvernement chinois a dû prendre des mesures politiques pour affaiblir la monnaie chinoise — le renminbi — et maintenir ainsi la compétitivité de sa production manufacturière. Il a en particulier acheté massivement des actions en dollars en imprimant massivement des renminbi. Mais le résultat a été d'injecter des montants considérables de monnaie dans l'économie chinoise facilitant toujours plus l'accès au crédit sur une longue période.
D'une part les entreprises et les gouvernements locaux ont employé ce crédit facile pour financer des investissements massifs. Ceci a conduit à une capacité de production de plus en plus excessive. D'autre part, ils ont employé le crédit facile pour acquérir des terres, des immeubles, des actions et toute sorte d'actifs financiers. Ceci a conduit à l'apparition des immenses bulles des prix des actifs qui, comme aux États-Unis, ont poussé à plus d'emprunts et plus de dépenses.
Si les bulles chinoises éclatent, la surcapacité de la production apparaîtra clairement. Si elles éclatent, on aura également, comme dans le reste du monde, un coup énorme porté à la consommation et une crise financière perturbatrice. Ainsi le résultat final, c'est que la crise chinoise est très sérieuse et peut encore aggraver la crise mondiale.
Seongjin Jeong : Vous pensez donc que la logique capitaliste de la surproduction s'applique également en Chine ?
Robert Brenner : Oui, autant qu'en Corée et dans la majorité de l'Asie de l'Est à la fin des années 1990. Ce n'est pas différent. La seule chose qui ne s'est pas encore produite c'est le genre de réévaluation de la monnaie qui a vraiment tué l'expansion manufacturière coréenne. Le gouvernement chinois fait d'ailleurs tout pour l'éviter.
Seongjin Jeong : Vous n'êtes donc pas d'accord avec la caractérisation de la société chinoise comme une sorte d'économie de marché non capitaliste ?
Robert Brenner : Pas du tout.
Seongjin Jeong : Donc vous pensez que la Chine est actuellement capitaliste ?
Robert Brenner : Je pense qu'elle est totalement capitaliste. Vous pourriez dire que la Chine avait eu une économie de marché non capitaliste peut-être au cours des années 1980, lorsqu'elle a connu une impressionnante croissance tirée par les entreprises appartenant à des villes et des villages. C'étaient des entreprises publiques, possédées par des gouvernements locaux, mais opérant de manière marchande. On peut dire que cette forme économique a initié la transition vers le capitalisme. Peut-être jusqu'au début des années 1990 il y avait donc une sorte de société marchande non capitaliste, surtout parce qu'il y avait toujours un grand secteur industriel possédé et planifié par l'État central. Mais il s'agissait d'une transition vers le capitalisme qui s'est maintenant accomplie.
Seongjin Jeong : Que pensez-vous de la sévérité de la prochaine crise économique coréenne ? Croyez-vous qu'elle pourrait être plus grave que celle de 1997-1998 provoquée par le Fonds monétaire international ? Pour faire face à la prochaine crise le gouvernement de Lee Myung-bak (4) a ressuscité maintenant les investissements dirigés par l'État dans la construction de l'infrastructure, en particulier le " Grand canal » de la péninsule coréenne dans le style de Park Chung-hee (5), tout en copiant la politique de la croissance verte d'Obama. Cependant le gouvernement de Lee Myung-bak essaye toujours de s'en tenir aux politiques néolibérales de déréglementation de la période post-1997, particulièrement en se tournant vers l'accord de libre-échange avec les États-Unis. On pourrait appeler cela une approche hybride, combinant le néolibéralisme contemporain avec ce qui ressemble à un retour anachronique à la méthode de développement étatique dirigiste dans le style de Park Chung-hee. Peut-elle s'avérer efficace en combattant ou en allégeant la crise à venir ?
Robert Brenner : Je doute de son efficacité. Pas nécessairement parce qu'il s'agirait d'une régression vers un capitalisme étatique dirigiste du style de Park, ni du fait du néolibéralisme, mais parce que, qu'elle que soit sa forme interne, cet accord continue de dépendre de la mondialisation au moment même où la crise mondiale provoque une extraordinaire contraction du marché mondial. Nous venons de parler de la Chine et je disais que l'économie chinoise est susceptible de connaître de sérieux ennuis. Mais la Chine dispose de salaires très bas et, potentiellement, d'un marché intérieur énorme ce qui pourrait la placer avec le temps dans une situation bien meilleure face à la crise que la Corée, bien que je n'en suis pas certain.
La Corée sera gravement atteinte à mon avis. Elle était gravement atteinte en 1997-1998 mais a été sauvée par la bulle du marché boursier américain et la croissance tirée par l'endettement, les dépenses et les importations des États-Unis. Lorsque la bulle boursière de Wall Street a éclatée en 2000-2002, la Corée est entrée dans une crise qui s'annonçait encore plus grave que celle de 1997-1998. Encore une fois la bulle immobilière états-unienne est alors venue à son secours… Maintenant celle-ci a éclaté et il n'y a aucune troisième bulle qui permettrait à la Corée d'éviter la crise actuelle.
Ce n'est donc pas nécessairement parce que la Corée fait fausse route. C'est parce que, à mon avis, il ne sera pas facile de trouver une quelconque issue locale dans ce qui est devenu un système capitaliste vraiment mondial et interdépendant.
Seongjin Jeong : L'environnement extérieur est donc selon vous bien pire qu'il n'a jamais été.
Robert Brenner : Là est l'essentiel.
Seongjin Jeong : Quelles sont alors les tâches urgentes pour les progressistes en Corée ? Ils sont très critiques de Lee Myung-bak car il est très réactionnaire. Habituellement ils sont favorables à l'État providence et à la redistribution des revenus qu'ils présentent comme une alternative au projet de Lee d'investissements étatiques massifs dans la construction du Canal. C'est aujourd'hui le point de tension de la société coréenne. Les progressistes coréens précisent que, bien que Lee Myung-bak parle de la croissance verte, son projet détruirait l'environnement. Êtes-vous d'accord avec eux ?
Robert Brenner : Nous devrions nous opposer à de tels projets écologiquement désastreux.
Seongjin Jeong : Pensez-vous que la construction d'une État providence à la suédoise pourrait constituer en pleine crise économique une stratégie raisonnable pour les progressistes coréens ?
Robert Brenner : Je pense que la chose la plus importante que les progressistes coréens pourraient faire serait de renforcer les organisations ouvrières coréennes. C'est seulement en reconstruisant le mouvement ouvrier coréen que la gauche disposera de la force dont elle a besoin pour arracher les demandes qu'elle préconise. La seule voie qui permet réellement au monde du travail de gagner des forces passe par la construction de nouvelles organisations au cours de la lutte et c'est seulement au cours des mobilisations qu'elles sont susceptibles d'arriver vers une politique progressiste ou de décider de quelle politique progressiste elles ont besoin à un moment précis.
Je pense que la meilleure manière de forger une réponse politique de gauche aujourd'hui c'est d'aider les plus démunis à se doter d'organisations et de la force pour qu'ils puissent décider collectivement de leurs intérêts. Autrement dit, plutôt que de tenter d'imaginer maintenant, de manière technocratique, quelle serait la meilleure réponse, la clef pour la gauche consiste à catalyser la reconstruction de la puissance du peuple travailleur.
Le mouvement ouvrier coréen a évidemment été très affaibli depuis la crise de 1997-1998. Au minimum la priorité pour les progressistes est de faire leur possible pour améliorer les conditions, pour organiser les travailleurs et pour renforcer les syndicats. Cela vaut non seulement pour la Corée, mais partout dans le monde. C'est l'objectif principal. Sans la renaissance de la force de la classe ouvrière, la gauche constatera rapidement que la plupart des questions de politique gouvernementale sont des questions uniquement académiques. Autrement dit, si la gauche veut influencer la politique des États, il faut un grand changement des rapports de forces entre les classes.
Seongjin Jeong : Espérez-vous que la récente faillite du néolibéralisme va produire une ouverture pour les progressistes de par le monde ?
Robert Brenner : La défaite du néolibéralisme ouvre certainement de nouvelles opportunités à la gauche. Le néolibéralisme n'a jamais été populaire. Les travailleurs ne se sont jamais identifiés au marché libre, à la liberté des finances, etc. Mais je crois que d'importants secteurs de la population avaient intégré l'idée qu'" il n'y a pas d'alternative ».
Maintenant que la crise a révélé la complète faillite du mode néolibéral d'organisation de l'économie on peut voir déjà le changement qui s'exprime par exemple par la très forte opposition des travailleurs américains face aux cadeaux pour les banques et le secteur financier. Aujourd'hui les gens disent : " On nous dit que le sauvetage des institutions financières et des marchés financiers est la clef pour restaurer l'économie et pour la prospérité. Mais nous ne le croyons pas. Nous ne voulons pas que notre argent aille encore à ceux qui ne font que nous voler. »
Il y a un vide idéologique et en conséquence une ouverture pour les idées de la gauche. Le problème, c'est que le niveau d'organisation des travailleurs est très faible et leur expression politique plus faible encore. On peut dire que le changement de l'environnement politique ou du climat idéologique forge de grandes opportunités, mais cela ne suffit pas en soi.
C'est pourquoi — une fois encore — la priorité des progressistes, de tous les militants de gauche, est d'agir pour la renaissance des organisations des travailleurs. Sans la reconstruction de la puissance de la classe ouvrière peu de changements progressistes seront possibles et la seule voie pour cela passe par la mobilisation en faveur de l'action directe. C'est uniquement par l'action collective de masse que les travailleurs pourront créer l'organisation et construire leur force. C'est nécessaire pour constituer la base sociale permettant la transformation de leur conscience et leur radicalisation politique. ■
1. Les emprunts hypothécaires — c'est-à-dire garantis par le prix estimé du logement — peuvent être contractés aux États-Unis non seulement pour l'achat du logement, mais pour toute sorte de dépenses : payement des études, des soins médicaux, d'autres achats y compris des placements boursiers… ce qui les rend d'autant plus risqués.
2. Le National Labor Relations Act (Loi nationale sur les relations syndicales) ou Wagner Act (en référence au sénateur Robert F. Wagner ) a été adopté en 1935. Cette loi défend les droits syndicaux des salariés du secteur privé, autorise la constitution des syndicats, les conventions collectives, la grève, ou toute forme de revendication collective. Elle a créé une nouvelle agence fédérale, le National Labor Relations Board (Comité National des Relations Syndicales ) qui avait le pouvoir de mener des enquêtes et de prendre des mesures contre des pratiques patronales injustes. La plupart des principes de cette loi ont été annulés par la Loi Taft-Hartley de 1947, instituée par les Républicains.
3. C'est-à-dire le consensus général imposé seulement en dernière analyse par la puissance militaire (note de la rédaction d'Against the Current).
4. Lee Myung-bak, candidat du Grand parti national, a été élu président de Corée du Sud en décembre 2007. Il avait été PDG de l'entreprise Hyundai Construction puis maire de Séoul.
5. Park Chung-hee a été président de la Corée du Sud de 1963 à 1979, après avoir pris la tête d'un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement civil en 1961 (mais dut remettre en place un gouvernement civil sous la pression de l'administration Kennedy des États-Unis). Sous son régime dictatorial le capitalisme sud-coréen a pris son essor.