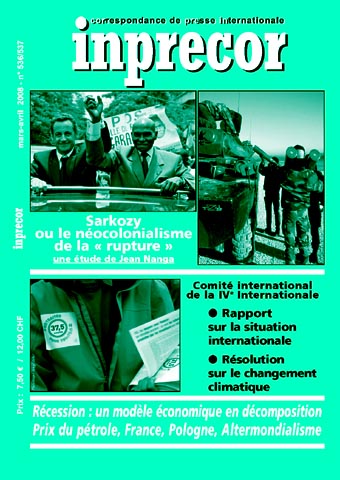Esther Benbassa : La souffrance comme identité, Éditions Fayard, Paris 2007, 20 euros
L'identité d'un groupe entremêle constructions sociales, constructions mentales, imaginaires collectifs, actes de foi ou de croyances, rationalisations des vécus et des compréhensions, écritures et réécritures du passé en fonction de choix religieux, scientifiques ou sociaux, de confrontation aux autres, d'inscription dans des lieux et temps concrets. Mémoires et histoires ne se recouvrent pas forcément, surtout lorsque le religieux, l'idéologie, le désir et la peur imprègnent ou dominent les perceptions.
J'utiliserai dans cette note le terme de juif, sans préjuger des débats nécessaires de définition sur la notion de peuple(s), nation(s), religion(s), etc. De même je choisis la formulation de Raul Hilberg " La destruction des Juifs d'Europe » aux termes " holocauste » ou " shoah » qui m'ont toujours paru inadéquats. J'assume par ailleurs le choix, sans vouloir porter atteinte aux croyances d'éventuel-le-s lecteurs et lectrices, de mettre tous les termes à connotation religieuse en minuscule (bible, écritures, talmud, dieu, croisade, exil, etc.). Je garde par contre la graphie de l'auteure.
Le livre d'Esther Benbassa est divisé en cinq chapitres.
" Souffrir, mourir, ritualiser » traite de la place de la souffrance dans l'ethos juif, dans les constructions bibliques et midrashiques (exégèses rabbiniques des écritures). " Une justification eschatologique et apocalyptique de la souffrance prend forme, soutenue par la croyance en une vie après la mort ».
L'auteure parcourt les mots et ordres religieux pour dégager les sens possibles de la souffrance comme relation au monde, punition ou bénéfice, relation à dieu, en soulignant les différences sensibles entre le catholicisme, l'islam et le judaïsme. Sans oublier que cette construction collective induit que " le ferment de subversion que recèle la souffrance est neutralisé par cette ritualisation qui, par cumul des catastrophes qu'elle englobe, libère en même temps un espace d'espérance ».
Cette plongée dans l'univers proprement religieux est indispensable car elle permet de comprendre comment " liturgie et mémoire se rejoignent pour bâtir une histoire souffrante ». L'auteure souligne par ailleurs que " cette gestion très particulière du souvenir du malheur apparaît d'emblée très différentes de notre attitude contemporaine séculière ».
Le chapitre deux " Fabriquer de l'histoire souffrante » est un parcours historique : première croisade (1096), le talmud brûlé vers 1240 à Paris par ordre du roi, expulsion d'Espagne en 1492, accusations de meurtre rituel et autres persécutions. Ces différents événements suscitent des chroniques qui vont devenir, perdurant encore de nos jours, une mémoire de souffrance " dénominateur commun d'un peuple en dispersion », une identité et une cohésion dans l'exil. " La souffrance primait l'histoire » et l'histoire des juifs se mémorisait uniquement comme histoire de malheurs. Il suffit de se pencher sur la réelle histoire des juifs au Moyen Âge pour montrer le caractère réducteur et mythique de cette translation (autonomie dans les ghettos, privilèges divers, statut social, qui évidemment n'éliminent pas les conséquences des menaces antisémites et des pogroms).
Par ailleurs, l'auteure signale que cette histoire ne nous dit rien sur ce qui faisait la spécificité du judaïsme d'alors, ni sur ses apports effectifs à la civilisation médiévale. Elle décrit les différences entre les mondes ashkénaze et séfarade, laisse une place importante à la littérature qui contribue à tisser génération après génération, cette histoire souffrante, interroge les différents moments proprement mystiques comme ceux de la kabbale. L'auteure ne néglige pas l'histoire des juifs dans l'empire ottoman.
Avec le XIXe siècle, en Europe, il s'agit d'une toute autre histoire, accès à la citoyenneté, sortie des ghettos, développement d'un courant des Lumières (haskala), échec de la Révolution de 1848, laïcisation et occidentalisation.
La destruction des juifs d'Europe par l'État nazi et ses complices dans la plupart des pays, dont le gouvernement de Vichy, modifie profondément les coordonnées : disparition du yiddishland et forcément questionnement pour les survivant-e-s. " Que faisait dieu à Auschwitz ? ». Ce chapitre " Une souffrance sans espérance » discute entre autres de l'unicité de cette destruction face aux autres génocides. Il faudra attendre les années 1960 pour un début d'historicisation savante de cette période. " En attendant, l'Holocauste comme religion de la souffrance a bel et bien été adopté par les masses juives ». Un événement sort de l'histoire pour devenir un moment sacré, par définition indiscutable, mémoire absolue, indéfiniment porteur de sens quelque soit la situation concrète sur lequel il est projeté (comme par exemple dans ses transcriptions juives en Palestine ou dans les relations entre Israël et les pays arabes).
Contre cette vision, Esther Benbassa souligne " Pour ne pas oublier, c'est d'histoire que nous aurions besoin, et non d'émotions, toujours fugitives, exigeant sans cesse d'être renouvelées, avec toujours plus d'intensité ». Cela nécessite aussi et surtout de nommer l'innommable.
Les chapitres suivants prolongent la réflexion " Une rédemption laïque ? La Shoah, Israël et les juifs » et " Hors de la souffrance, point de salut ! » sur lesquels je ne m'étends pas, car je suis intervenu, dans ces colonnes à de nombreuses reprises en chroniquant des publications. Je partage avec l'auteure bien des appréciations et particulièrement la nécessaire dimension universelle de cette histoire particulière et " la reconnaissance des mémoires meurtries » comme " étape indispensable des identités individuelles et collectives dans nos sociétés de plus en plus sécularisées ».
Et l'auteure de conclure par " Le droit à l'oubli ». Nous ne pouvons nous considérer principalement comme victimes, la judéité n'est pas réductible à l'antisémitisme, la négritude à l'esclavage, etc. Une telle vision rétrécit l'horizon, naturalise des inscriptions historiques, enferme dans la négation de soi comme individu-e et comme collectivité. " La victimité n'est pas inscrite dans le code génétique d'un groupe ».
D'où une interrogation pertinente : " Ceux qui, sans répit, veillent sur la mémoire et en font un devoir sont-ils prêts à lâcher prise pour autoriser l'oubli, qui n'est pas effacement de l'événement, mais seulement sortie de la mémoire, désormais confiée à l'histoire, comme on laissait hier au texte la charge de rappeler, à cadences régulières, les désastres du passé ? »
Penser et réfléchir c'est aussi sortir des sentiers habituels, c'est parfois pour un-e mécréant-e se confronter aux constructions religieuses qui ont été tant importées avant le règne de l'individu citoyen abstraitement égal et la domination de la marchandise.
Mais il ne faut pas se tromper, le resurgissement de la question religieuse, l'actualité d'un archaïsme, pour utiliser un beau titre d'Alain Birh, est une toute autre question.