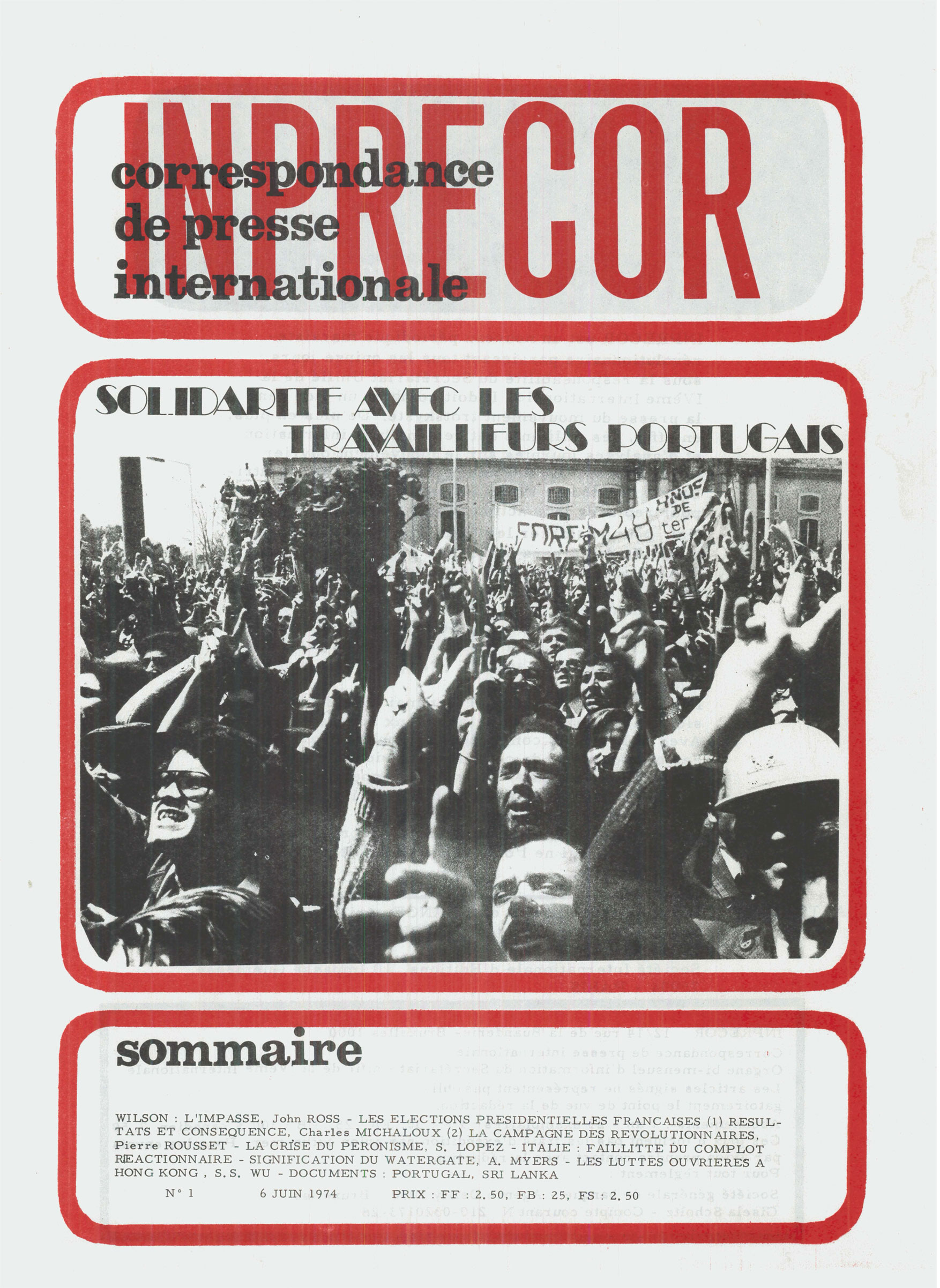Écrasé chez les travailleurs, battu par les moins de 35 ans, ignoré par les moins de 21 ans et les 3 millions de travailleurs immigrés qui ne votent pas, Giscard d'Estaing est l'élu d'une minorité. Il ne règnera pas. En tous cas sûrement pas 7 ans, ni même 5 ans.
Face aux 50,7 % de voix recueillies par Giscard, dans une campagne dominée par les incantations traditionnelles devant la peur du rouge (en l 'occurence la possibilité d'une participation ministérielle du Parti Communiste français au gouvernement formé par Mitterrand), où le taux de participation constitue un record dans lesannales électorales françaises ( 13% d'abstentions seulement), la candidature de François Mitterrand a rassemblé 49,3 % des 27 millions de suffrages exprimés, soit 13 millions de voix.
Giscard d'Estaing ne doit ainsi son élection qu'à 300.000 voix sur 27 millions.
Si les élections sont une expression déformée (au détriment des travailleurs) du rapport de forces entre les classes, c'est là un résultat impressionnant.
Le vote Mitterrand, un vote de classe.
Reste cependant à établir qu'il s'agit bien là du reflet électoral du combat que la classe ouvrière alliée à tous les travailleurs mène contre la bourgeoisie. En d'autres termes que la candidature Mitterrand, ce n'est pas une opération d'une partie de la bourgeoisie contre une autre, à l'instar de Péron en Argentine ou même de McGovern aux États-Unis, dans de toutes autres circonstances.
Certes, Mitterrand a fait campagne pour devenir le « Président de tous les Français », multipliant des déclarations rassurantes pour les capitalistes et des sourires séduisants à l'égard des gaullistes.
Mitterrand a mis beaucoup d'eau dans le vin déjà passablement coupé de l'Union de la gauche et du Programme commun élaboré par le Parti socialiste et le Parti communiste à la veille des élections législatives de mars 1973. Mais est-ce là vraiment une nouveauté qui aurait pu justifier que les militants trotsykstes du Front communiste révolutionnaire n'appelaient pas à voter pour Mitterrand le 19 mai dernier ?
Répondre affirmativement à cette question, que se sont posés quelques secteurs ultraminoritaires, d'avant-garde français ou internationaux. signifie essentiellement que l'appel à voter pour un candidat, un parti ou un bloc réformiste, dépend avant tout du programme que celui-ci développe au cours de sa campagne.
Or, c'est l'inverse qui est vrai. Dans certaines situations, les communistes révolutionnaires peuvent appeler à voter pour un candidat, un parti ou un bloc à condition que celui-ci réponde au critère fondamental d'appartenance au mouvement ouvrier, et ce, malgré, contre le programme réformiste de collaboration de classe développé par ce candidat, ce parti ou ce bloc.
Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, était le candidat commun du Parti socialiste, du Parti communiste, du Parti socialiste unifié, des grandes centrales syndicales ouvrières CGT et CFDT et du syndicat unique des enseignants : la FEN.
À ce titre, il était le candidat unique des grandes organisations ouvrières, toutes tendances réformistes (stalinienne, social-démocrate et centriste) confondues. Seuls les radicaux de gauche, groupuscule bourgeois, débris du Parti radical qui faisait la pluie et le beau temps de la IIIe République avant la Deuxième Guerre mondiale, détonnent dans ce tableau de famille. Leur présence au sein de l'Union de la gauche, et donc dans l'alliance des formations qui a soutenu Mitterrand dès le premier tour des élections présidentielles, témoigne évidemment de la volonté des directions réformistes de se donner une caution modérée pour « rassurer » les couches petitesbourgeoises qu'elles espèrent ainsi rallier à bon compte.
Mais personne ne peut prétendre sérieusement que la présence des radicaux de gauche dans l'Union de la gauche et donc dans l'alliance qui appuya la candidature de Mitterrand suffise à marquer celle-ci du sceau d'un front populaire, au sens exact et traditionnel du terme : une coalition des partis ouvriers réformistes avec un (ou plusieurs) partis bourgeois significatifs, comme cela fut le cas en France et en Espagne en 1936, en France et en Italie en 1945.
Les rogatons de feu le Parti radical ont rassemblé aux dernières élections législatives de mars 1973, avec la bienveillance du PS qui ne lui opposait aucun candidat, 2 % des voix, c'est-à-dire moins que les révolutionnaires réunis de la Ligue communiste et du groupe Lutte ouvrière.
Leur présence dans l'Union de la gauche n'est pas le résultat d'une volonté délibérée d'une fraction de la hourgeoisie déterminée à canaliser ainsi la montée menaçante de la combativité ouvrière par une opération de Front populaire, mais la conséquence d'une respiration artificielle pratiquée par le PCF et le PS sur un cadavre vieux de 25 ans, aux seules fins de la propagande électoraliste. De la même manière, le soutien accordé entre les deux tours à la candidature de Mitterrand par quelques dissidents gaullistes ne dépasse pas les limites des pitreries de fin de régime. De Gaulle et Pompidou disparus, Chaban-Delmas mort-né, ils ne pouvaient se résigner à voter pour un Giscard qui avait chassé leur Dieu, comploté dans l'ombre de son apôtre et donné le coup de pied de l'âne à l'un de ses saints.
Mais derrière ces ralliements de la 25e heure, gaullistes ou réformateurs, c'est en vain qu'on chercherait un secteur particulier de la bourgeoisie qui aurait consciemment fait le choix d'une politique, fut-elle celle du pire.
Tout au plus, on peut y voir une préfiguration de ce qu'aurait probablement initié une victoire électorale de Mitterrand, en termes de manœuvres et de combines parlementaires, avant et après la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation des nouvelles élections législatives. Cette dynamique de collaboration avec un secteur de la bourgeoisie, les militants du Front communiste révolutionnaire dans leur campagne, la dénonçait à l'avance, notamment en posant comme condition à leur appel à voter Mitterrand que celui-ci ne passe aucun accord avec un parti significatif de la bourgeoisie. Mitterrand fit tout pour rassurer la bourgeoisie sur ses intentions, se présenta comme le seul garant de la paix sociale, mais ne se risqua pas à accepter, par exemple, les appels d'offre de Jean-Jacques Servan Schreiber, qu'il refusa.
Au matin du 19 mai, François Mitterrand, peut-être malgré lui — mais c'est bien secondaire en l'occurrence — était le candidat des principales organisations ouvrières réformistes, en qui des millions voyaient une solution pour se débarrasser d'un régime vieux de 16 ans, qui avait dressé contre lui l'écrasante majorité des forces de la jeunesse et du travail.
Les militants révolutionnaires ont appelé à voter Mitterrand le 19 mai, en dépit de son programme de collaboration de classe, mais parce qu'il était le représentant des directions réformistes, stalinienne et centriste ou social-démocrate, majoritaires dans le mouvement ouvrier organisé, qui drainait sur son nom un immense courant populaire, courant qu'on vit d'ailleurs se manifester dans les rassemblements monstres tenus dans les principales villes de France (Paris 150.000, Toulouse 40.000, Grenoble 40.000, Marseille 50.000, Nantes 25.000, Nancy 20.000, etc.).
Les militants révolutionnaires s'adressaient ainsi aux travailleurs en leur disant : « Voilà, pensez qu'avec. » Mitterrand, ça va changer, que vous allez crier pour être débarrassés de ce régime d'exploitation et d'oppression. Nous ne le croyons pas, car nous n'avons confiance ni dans Mitterrand ni dans les directions qui le soutiennent pour défendre les intérêts des masses laborieuses et marcher au socialisme ; et nous l'avons dit dans notre campagne avant le premier tour, par la voix de notre candidat Alain Krivine.
Mais si nous avons marché séparément, nous sommes prêts aujourd'hui à frapper ensemble, pour battre Giscard et la réaction en votant pour Mitterrand. S'il perd, il ne pourra pas nous en rendre responsables ; s'il gagne, il ne pourra pas se prévaloir d'une seule défection pour ne pas réaliser le minimum de ce qu'il a promis.
Mitterrand vainqueur, les conditions deviendront certes plus favorables aux exigences ouvrières et populaires. Mais les travailleurs, d'ores et déjà, ne doivent compter que sur leurs luttes pour obtenir satisfaction, sur leur organisation autonome pour garantir leurs conquêtes et aller de l'avant.
Dans ce combat, nous vous avertissons que, tôt ou tard, Mitterrand et les dirigeants réformistes qui le soutiennent se trouveront en travers de votre route. Si vous ne croyez pas sur parole, vous jugerez bientôt sur les actes, quand vous en aurez fait l'expérience. Nous sommes prêts à la faire avec vous. Contre le rassemblement de la droite et de l'extrême droite bourgeoise coalisées derrière Giscard, le candidat des banquiers et des patrons, nous voterons avec les travailleurs pour Mitterrand, mais sans lui donner un chèque en blanc. »
Ainsi, le vote pour Mitterrand n'impliquait en aucune mesure une caution, même critique, à Mitterrand, mais plus simplement un vote qui était déterminé par l'effet objectif sur le développement de la lutte de classe en France d'une victoire de Mitterrand.
L'importance de la poussée électorale à gauche
13 millions de voix, plus de 49 % des suffrages exprimés : la poussée électorale de la gauche n'avait jamais atteint un tel score.
En 1936, ce sont environ 48 % des voix qui se portaient sur les listes du Front Populaire (incluant environ 1/3 des radicaux). En 1945, ce sont environ 45 % des voix que rassemblaient la SFlO et le Parti communiste, et dans les deux cas dans des circonstances politiques totalement différentes, où socialistes et communistes faisaient partie d'une coalition, l'Union nationale anti-fasciste ou l'issue de la résistance. Un tel niveau n'avait jamais été obtenu par les partis réformistes, et de loin, ni en 1956 (42,6%), ni au second tour de l'élection présidentielle de 1965 (45,5% contre de Gaulle), ni lors des élections législatives de mars 1967 (43,7 %) ou de mars 1973 (46,7 %). Si l'on tient compte, pour les comparaisons de l'augmentation du nombre des votants et du très faible taux d'abstentions (0,2 % en France, sans compter les colonies), un tel score reflète incontestablement la montée de la combativité ouvrière et surtout, six ans après, le contre-coup de la grève générale de mai 68, dont les leçons ont mûri et pénétré peu à peu toute une génération ouvrière.
L'Union de la gauche formée pour les législatives de mars 1973 et la candidature de Mitterrand constituent en effet la réponse réformiste à retardement au formidable ébranlement de Mai 68 ; au-delà des promesses et des litanies électorales, c'est cette onde de choc qui atteint aujourd'hui la vie politique française. Et, dans la classe ouvrière, le débat portait clairement sur « voie réformiste » ou « voie révolutionnaire » au socialisme.
Ce mouvement, en plein essor, ne peut être arrêté, encore moins brisé par un échec électoral de trois cent mille voix sur 27 millions de votants. Il serait naïf de s'attendre à ce que la classe ouvrière en tire dans sa masse des conclusions anti-électoralistes : les élections ne paient pas, seul le combat paiera. Mais les travailleurs, c'est certain, ont éprouvé et mesuré leur force, senti la victoire à portée de la main. Les quelques semaines de déception passées, ils n'en resteront pas là.
Fait contradictoire, ce résultat sans précédent de la gauche fournit, par rapport aux luttes ouvrières et de la jeunesse, une perspective politique même réformiste, qui manquait pour centraliser l'offensive de 1968, même si, dans le même temps, ce résultat (presque la barre des 50 %, et ce, presqu'à cause du trucage électoral), contribue à maintenir les illusions électoralistes. Aucune échéance électorale n'est officiellement prévue avant les nouvelles législatives de 1978 ou les futures présidentielles de 1979 (en cas de quinquennat) ou de 1981 (en cas de septennat). Ceci rend évidemment la situation de l'Union de la Gauche, du PS et du PCF quelque peu difficile : il leur est pour le moins malaisé, vu le niveau actuel de la combativité, de promettre que la prochaine fois sera la bonne et qu'il faut patienter.
Mitterrand lui-même le sent et le sait. Il a répondu à Giscard qui, au soir du 19 mai, saluait son « adversaire moins heureux », qu'« une fois encore, les formidables puissances de l'argent (avaient) de justesse barré la route aux forces du travail et de la jeunesse ». Reprenant ses fonctions à la direction du Parti socialiste, il déclara même qu'il ne saurait y avoir « ni trêve, ni pause » et que « le combat continue. ». La campagne de Mitterrand ayant atteint un de ses objectifs – la réintégration du PCF dans la vie nationale après la période du ghetto – et fait accepter massivement, y compris par une partie lucide de la bourgeoisie, l'idée de revoir des ministres communistes au gouvernement, Mitterrand et les dirigeants réformistes savent donc que dans une situation économique et sociale tendue, sinon explosive, face à un régime qui trouvera difficilement son équilibre, ils peuvent le cas échéant apparaitre comme des sauveurs de la société établie. Beaucoup plus qu'à la veille de la campagne, en raison des gages de bonne conduite donnés par le PCF et des garanties fournies par Mitterrand et le PS, une partie de la bourgeoisie est prête à envisager cette éventualité en cas de crise grave.
Cela confirme que, plutôt que par un changement d'alliance, c'est en tant que telle, PCF inclu et sans nouvelle composante bourgeoise, que l'Union de la gauche peut devenir, en cas de crise, une ultime solution de la bourgeoisie.
La chute du gaullisme
Dans les colonnes de sa presse, au lendemain des résultats du 2e tour, la bourgeoisie avait le triomphe modeste. Prudence ? Tactique momentanée destinée à arrondir les angles taillés à vif des deux blocs politiques et sociaux, dans les villes et les campagnes, révélés par ces élections ?
La raison en est à la fois plus simple et plus profonde.
On peut situer l'analyse dans le cadre des différences entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Dans la démocratie parlementaire, le gouvernement est désigné par les députés et responsable devant eux ; en cas de conflit, le gouvernement peut en revanche dissoudre le Parlement et recourir à des élections générales pour tenter de trouver un nouvel équilibre entre les différents intérêts bourgeois qui s'affrontent par cliques, clans et partis interposés.
Le Président (ou le Roi) n'est qu'un attribut décoratif et ne joue qu'un rôle politique effacé derrière le pouvoir réel du gouvernement, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Suède, en Belgique.
Dans un régime présidentiel, dont les États-Unis constituent l'exemple classique, l'intégralité du pouvoir exécutif revient au contraire au chef de l'État : le Président élu au suffrage universel nomme les ministres qui ne sont responsables que devant lui. Mais il n'a pas le pouvoir de dissoudre le Parlement qui fait les lois ; c'est aussi pourquoi un régime présidentiel solide — ce que n'est pas l'actuelle administration nord-américaine — suppose l'existence d'un grand parti bourgeois parlementaire, capable d'appuyer dans son domaine la politique établie par le président. En France, le gaullisme a imposé un régime bâtard et d'exception, surtout à partir du référendum de 1962 instituant l'élection du Président de la République au suffrage universel.
La démocratie parlementaire était paralysée par le morcellement des intérêts bourgeois, par l'affrontement des groupes de pression d'autant plus nombreux que la petite-bourgeoisie rurale et commerçante avait en France de solides et profondes racines, dans la composition sociale archatque de la société capitaliste française. La constitution de 1958, complétée par des dispositions de 1962, autorise le président à dissoudre l'Assemblée, à légiférer par décrets et ordonnances, à modifier la constitution par référendum, sans consulter les députés.
C'est la forme gaulliste de l'État fort avec son cortège d'abus de pouvoir, d'arbitraire, de « pouvoir personnel ». Mais cette forme ne pouvait être que transitoire. Le régime gaulliste est né sur la base de la défaite ouvrière de 1958. Il a cherché à se fonder sur cette passagère apathie de la classe ouvrière, à l'embrigader derrière une idéologie propre : celle de la participation.
En tentant d'intéresser les travailleurs aux bénéfices des entreprises, c'est-à-dire de les associer à la course à la productivité, le gaullisme voulait s'adresser à eux par-dessus la tête de leurs organisations, partis et syndicats. Pour cela, il fallait s'adresser à la France directement, sans intermédiaire : les référendums-plébiscites firent un temps l'affaire, jusqu'au dernier, celui de 1969.
Il fallait aussi déstructurer les partis existants au profit d'un grand rassemblement, soit-disant au-dessus des classes et des partis : l'UNR (Union nationale de la République), puis l'UD-V (Union démocratique de la Ve République), puis l'UDR (Union pour la défense de la République) auraient dû être cet outil pour capter les voix d'un électorat populaire atomisé. Mais la tentative fit long feu : dès 1963, la grève des mineurs marquait la reprise de la résistance ouvrière. La grève générale de Mai 68 fut le coup de boutoir final qui jeta bas, un an après, le Bonaparte. Une fois disparu l'homme providentiel et réduit électoralement son rassemblement à vocation populaire, les épigones du gaullisme ne pouvaient que se survivre en attendant l'agonie.
Passée l'euphorie expansionniste des années 60, la nouvelle société, les contrats de progrès, prônés par Chaban Delmas dans sa campagne, n'étaient déjà plus que les pâles ersatz des grandes ambitions gaullistes de participation. L'UDR, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été, était moins que jamais propice à devenir « ce grand rassemblement au-dessus de la droite et de la gauche ». De recul en défaite, elle est tombée au rang de parti parlementaire bourgeois parmi d'autres et désormais moins homogène que les autres. Les 15 % de voix recueillies par Chaban, son échec, l'échec définitif du gaullisme, ne sont que la conclusion de ce long processus entamé après le coup d'État du 13 mai 1958. Le coup mortel date de mai 68, le reste était inéluctable et irréversible.
Giscard : Sur le fil du rasoir
Quelque temps hésitante, la bourgeoisie comprit vite que Giscard faisait mieux l'affaire que Chaban. Giscard ne s'est guère embarrassé dans sa campagne des grands projets gaulliens de participation ou de contrats de progrès. Il ne propose pas une politique axée sur la collaboration des classes, tant il prévoit les affrontements inévitables, probablement dès la rentrée sociale de septembre.
Chaban mettait en garde : « On voit la France menacée d'être séparée en deux camps hostiles l'un à l'autre, deux camps qui mèneront le pays à une impasse, avec des troubles sociaux dans les entreprises et dans la rue. » Giscard, lui, sait bien que telle est, de toutes façons, la situation qu'il reçoit à l'issue de cette campagne. Il faut d'abord s'employer à regrouper les forces capables de se préparer à y faire face. Il prétend plutôt regrouper, soit l'aile protectrice de la grande bourgeoisie, dont il est un des plus beaux fleurons, toute cette poussière d'humanité apeurée et conservatrice à l'aide d'un habile saupoudrage électoral.
Giscard tentera probablement d'endiguer le flot montant des revendications ouvrières en lâchant, au moins dans les premiers temps, un peu de lest. Il pourra s'efforcer de justifier ses prétentions sociales en décrétant quelques mesures, peut-être « spectaculaires », qu'il compte bien faire financer par l'inflation. L'inflation continuera à son rythme actuel et inquiétant et fera resurgir bientôt l'important problème du chômage croissant. On comprend mieux pourquoi les vainqueurs ne plastronnent pas outre mesure. C'est qu'ils sont terriblement inquiets. Si les nuages s'amoncellent dangereusement au-dessus du terrain des luttes sociales, le ciel institutionnel n'est pas plus bleu. Giscard se retrouve à la tête d'une coalition transitoire et hétéroclite. Il est contraint de dénoncer les contradictions d'un régime conçu par et pour De Gaulle. Il doit s'efforcer d'instaurer un régime présidentiel qui élimine les risques de conflit sans issue entre l'exécutif qu'il incarne et une assemblée qui risque de retomber dans le morcellement et les jeux d'alliance changeantes.
Mais pour cela, il lui faudrait disposer d'un solide parti conservateur absorbant les débris gaullistes et réformateurs. Il n'a qu'une fragile coalition électorale, où son parti (les Républicains indépendants) ne constitue qu'une petite minorité, et dans laquelle siègent des réformateurs à la docilité exigeante et une UDR, au moins en partie, sourcilleuse de préserver l'orthodoxie défendue.
Si Giscard a intérêt, dans l'immédiat, à ne pas prolonger la période d'instabilité et la période électorale qui a retardé une série de mesures urgentes à prendre de son point de vue, il devra pourtant essayer, dès que possible, de se doter d'un appui parlementaire plus solide, au prix d'élections législatives anticipées, donnant ainsi l'occasion de nouvelles batailles à l'Union de la gauche.
Il peut s'atteler à la tâche, mais elle est loin d'être simple. La base électorale d'un grand parti bourgeois, démocrate-chrétien (comme le MRP de 1945) teinté d'humanisme social pour collecter les voix populaires, n'existe plus dans les mêmes proportions.
L'existence d'un mouvement ouvrier organisé et puissant ne permet pas que se rassemble facilement un grand parti libéral bénéficiaire, à l'américaine, d'une clientèle ouvrière et populaire.
Le changement, par la majorité nouvelle, que promettait Giscard à ses auditeurs bourgeois, paraît bien compromis.
L'ère nouvelle dont parlait Giscard le soir même de son élection de justesse ne s'annonce guère comme une ère de grands projets et de politique rigoureuse pour la bourgeoisie, mais bien plutôt comme celle d'un régime conservateur décadent.
Un gouvernement de transition, comme l'est déjà le gouvernement désigné avec son Premier ministre Chirac, issu des rangs de l'UDR, mais rejeté par ses collègues, obligé de faire le pont entre une majorité ancienne que ses rivalités internes minent de toutes parts, et une majorité nouvelle que des grandes luttes sociales empêcheront peut-être de jamais voir le jour.