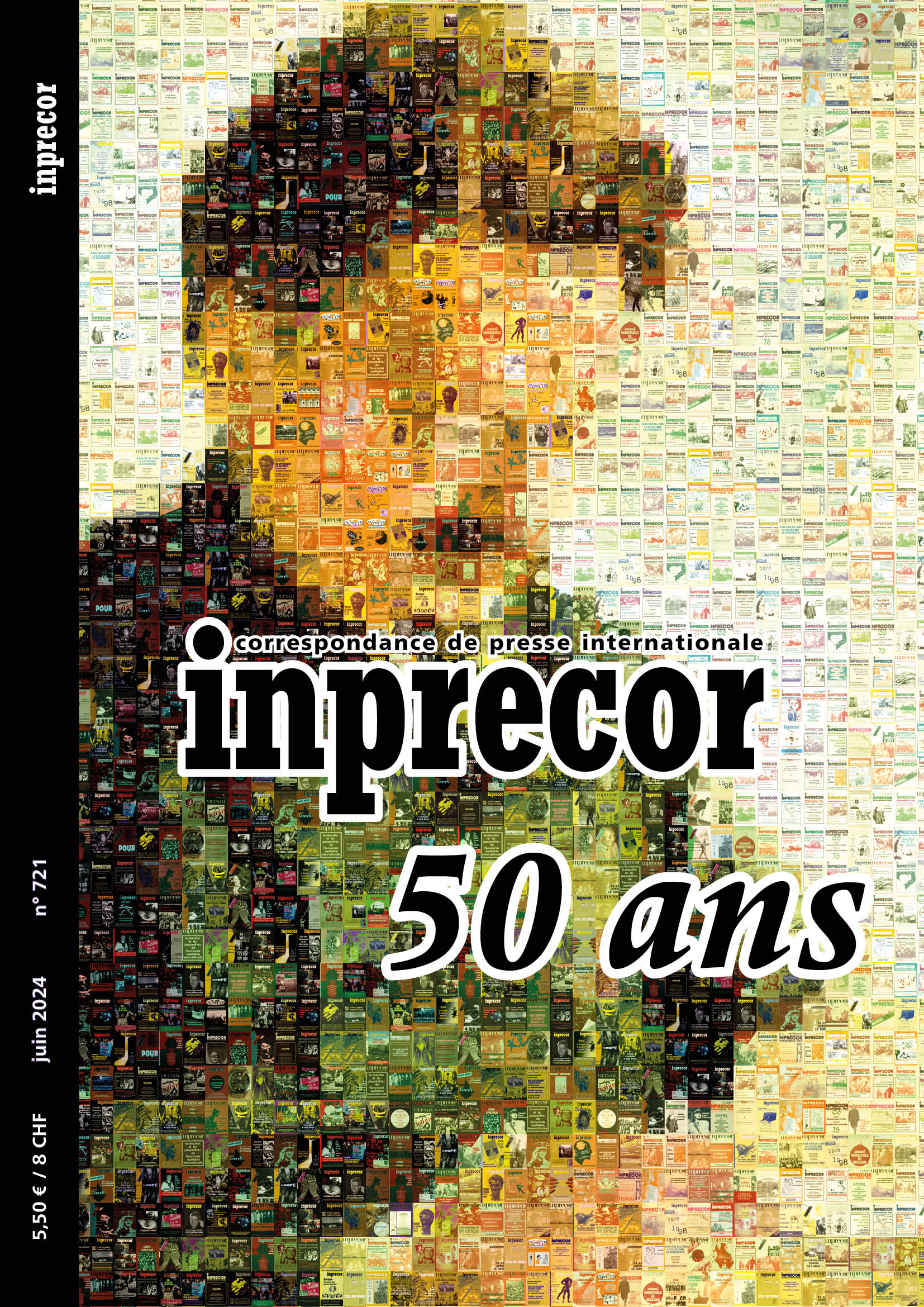Nous publions la préface rédigée par Franck Gaudichaud et Éric Toussaint à la demande de la revue cubaine Temas pour un livre coordonné par Julio César Guanche à paraître en Argentine sous le titre Izquierdas y derechas en America latina.
Le monde de ces dernières années a été marqué par de multiples crises. On pourrait parler d’une « polycrise » globale, intersectionnelle et interconnectée du capitalisme néolibéral : turbulences politiques et économiques profondes, guerres et violences armées, effondrement accéléré des écosystèmes et du climat, pandémies et extractivisme prédateur, redéfinitions brutales des équilibres géopolitiques et tensions inter-impérialistes, etc. Une fois de plus, l’humanité traverse des ouragans et des défis majeurs dans un moment historique où, manifestement, sa survie même en tant qu’espèce et son (in)capacité à habiter collectivement et pacifiquement cette planète sont d’ores et déjà en jeu. La grande révolutionnaire allemande Rosa Luxemburg déclarait, dans les années 1910, alors qu’il était minuit dans le siècle dernier : socialisme ou barbarie ! Ce slogan résonne très fort aujourd’hui1 , dans un contexte où les peuples et les mouvements populaires continuent de résister, de se mobiliser, de débattre, de proposer, mais sans parvenir à surmonter la fragmentation structurelle, ni - pour l’instant - à voir des forces politiques émancipatrices ayant une réelle capacité à accompagner, consolider ces résistances et construire un cap à moyen terme pour des alternatives démocratiques et éco-sociales « raizal », pour citer le sociologue colombien Orlando Fals Borda (1925-2008).
Cependant, si l’on observe les Amériques « latines » et les Caraïbes au cours des deux dernières décennies, les terres de Berta Cáceres (1971-2016), José Carlos Mariátegui (1894-1930) et Marielle Franco (1979-2018) semblent chercher de nouvelles voies sociales et politiques, réveillant les espoirs de la gauche mondiale, au-delà de la chute du mur de Berlin et d’un néolibéralisme vorace. « Tournant à gauche », « vague progressiste », « fin du néolibéralisme », « marée rose » : l’inflexion sociopolitique vécue par de nombreux pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale dans les années 2000 a surpris beaucoup d’observateurs et d’observatrices et même fasciné beaucoup d’autres, notamment en Europe2 . Le défi - en particulier pour des pays comme la Bolivie, le Venezuela et l’Équateur, qui ont construit un narratif et une promesse « transformatrice » - était de trouver des voies politico-électorales et nationales-populaires avec une clé « post-néolibérale » et anti-impérialiste. Pour certains militant.e.s et mouvements, il ne s’agissait pas seulement de « démocratiser la démocratie », mais aussi de ne pas rester enfermé dans un nouveau modèle fondé sur l’extractivisme des matières premières, la soumission au marché mondial et diverses formes de colonialisme interne et externe.
Plus de 20 ans après le début de ce « cycle », nous pouvons constater à quel point cet objectif de transformation n’a pas été atteint, bien qu’à des rythmes et des réalités très différents selon les scénarios régionaux et nationaux d’Abya Yala3 . Obstacles et difficultés, désenchantement et désillusion ont été communs à plusieurs pays gouvernés par la gauche et le « progressisme », sans qu’une dynamique homogène ne soit perceptible. Parallèlement, les forces conservatrices et les nouvelles extrêmes droites ont su capitaliser sur ce contexte de crises multiples, pour imposer de nouveaux récits politiques et culturels furieusement « antiprogressistes », soutenus par les grands groupes médiatiques et par les oligarchies économiques locales et impériales, afin, in fine, de se poser en « alternatives populaires » : Javier Milei est le dernier maillon de cette chaîne réactionnaire globale4 . Nayib Bukele Ortez, réélu à la présidence du Salvador en février 2024, a développé un style de gouvernement qui rappelle l’expérience de la présidence de Rodrigo Duterte aux Philippines entre 2016 et 2022, durant laquelle des milliers d’exécutions extrajudiciaires contre des secteurs populaires « lumpénisés » ont été menées par les forces répressives sous son contrôle au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Daniel Noboa, élu président de l’Équateur en 2023, pourrait tenter d’aller dans ce sens.
Comme le montre ce livre, il est essentiel d’établir un bilan critique et argumenté des dernières décennies, du point de vue des sciences sociales et de leur méthodologie, en approfondissant et en débattant les essais et les publications qui tentent de décrypter l’Amérique latine d’aujourd’hui. L’objectif est d’analyser dans sa complexité changeante la période ouverte dans les années 2000 (avec l’élection d’Hugo Chávez en 1999), produit des luttes sociales et populaires contre l’hégémonie néolibérale de la période précédente. Un premier sursaut suivi d’une multiplicité de victoires électorales permettant un relatif « âge d’or » (entre 2005 et 2011) de la gauche et des gouvernements progressistes, avec diverses formes d’État compensateur et redistributeur, une baisse notable de la pauvreté et de nouvelles formes de participation politique, période suivie d’un net reflux régional, d’une baisse du prix des matières premières et d’une embellie conservatrice (2011-2018), marquée - entre autres - par la crise profonde de la « révolution bolivarienne », débouchant sur le moment chaotique post-pandémique des dernières années (2019-2023), où l’on a assisté à la victoire de Bolsonaro au Brésil, à la confirmation des dynamiques de droite en Équateur, mais aussi à des soulèvements populaires au Chili, en Haïti, en Colombie, au Pérou et en Équateur. Dans le même temps, une troisième nouvelle « vague » de gauches institutionnelles( ou « progressisme tardif » selon Massimo Modonesi), clairement limitée (par rapport au début du siècle), a commencé à prendre forme au Chili avec l’élection de Gabriel Boric (2021), en Colombie avec la victoire de Gustavo Petro (2022), Honduras avec la présidence de Xiomara Castro (2022), Guatemala avec l’élection de Bernardo Arévalo en 2023 mais aussi - depuis 2018 - avec l’élection de Manuel López Obrador au Mexique ou en 2020 avec le retour démocratique du Mouvement pour le Socialisme (MAS) en Bolivie.
Cet ouvrage collectif, coordonné par le chercheur Julio César Guanche et publié par la revue cubaine Temas, nous invite à comprendre ces processus à partir de différents points de vue, géographies et sensibilités. L’intérêt principal de cette publication est de couvrir les réalités politiques et sociales de plusieurs pays : l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Équateur, le Mexique, le Pérou et Cuba, à partir d’un examen critique des continuités et des nouveaux phénomènes dans la région, en particulier les transformations sociales et culturelles souterraines qui sous-tendent les changements politiques en cours. Ainsi, ce livre pluraliste traite des processus de gauche ou « progressistes » au pouvoir, ainsi que des processus conservateurs et réactionnaires. Il décrit les dimensions plébéiennes du populisme ou de l’extrême droite (en Équateur, au Brésil et au Pérou), et décrypte les contradictions des progressistes au pouvoir. Si les auteurs envisagent ici les aspects partisans et institutionnels (par exemple, à propos de la droite équatorienne ou de la gauche chilienne et mexicaine), ce n’est pas sans laisser de côté le vaste champ des mobilisations collectives et de la société civile organisée : mouvements sociaux afro-descendants, luttes féministes et anti-féministes, mouvements religieux fondamentalistes, mouvements indigènes sont tous présents dans cet opus. Sans aucun doute, la diversité des approches et des origines des chercheurs inclus ici, qui ont tous une longue histoire de travail et de vie dans différents pays de la région, permet au lecteur d’offrir une vision intéressante, plurielle et contrastée du continent à l’heure actuelle.
Le politologue Noberto Bobbio, dans son ouvrage désormais classique, Droite et gauche, essai sur une distinction politique5 a souligné de manière convaincante que la distinction des deux pôles de ce binôme peut être un bon point de départ pour réfléchir à une carte politique. Dans cette distinction, Bobbio part de l’axe liberté/égalité pour classer les forces politiques : les droites revendiquant de manière privilégiée le concept de « liberté » (du marché et/ou de l’individu en particulier) et les gauches celui d’« égalité » (et d’émancipation sociale et collective). En transposant cette réflexion à l’Amérique latine et aux Caraïbes, et en rompant avec les visions eurocentriques, il serait nécessaire d’introduire un ensemble d’autres concepts pour penser cette distinction, tels que la colonialité du pouvoir et les conceptions nationales/plurinationales de l’État, les notions de souveraineté populaire et d’anti-impérialisme, les droits des peuples indigènes et les rapports sociaux de race ou de genre, les modèles de développement et les modèles socio-environnementaux, etc. Au-delà de ces caractérisations, ce sont surtout les zones grises et les recoins des espaces sociopolitiques latino-américains actuels que ce livre confirme, des espaces qui ne se résument pas à une simple dichotomie gauche/droite. Cette publication propose des versions actualisées de textes parus dans un dossier de la revue Temas en 2022. Dans leur présentation, les coordinateurs notent à juste titre :
« L’arrivée de nouveaux gouvernements de gauche et de centre-gauche identifiés comme la « marée rose » en Amérique latine et dans les Caraïbes ne fait que renvoyer à un phénomène électoral, dont l’environnement politique est plus complexe. En son sein coexistent des différences stratégiques, des croisements de bases sociales entre les zones de gauche et les zones conservatrices, comme le néo-évangélisme, le rejet de l’autoritarisme de certains mouvements progressistes, des critiques sur les questions de genre, la justice raciale et environnementale, les revendications des peuples indigènes, et d’autres sujets à l’ordre du jour politique, comme la transition énergétique, la perpétuation de l’extractivisme et sa corrélation avec un système de démocratie populaire, qu’il s’appelle socialisme ou non« . Bien qu’ils aient perdu des sièges au gouvernement, les courants conservateurs ont gagné une base populaire, comme le reflète non seulement leur représentation parlementaire, mais aussi le renforcement du consensus néolibéral parmi ces autres bases, sur la »liberté« et la »démocratie« et contre le »populisme". Ces courants n’ont pas cessé d’utiliser la répression pour maintenir un régime d’inégalité caractérisé par une grande dévastation sociale ».6
Plus que jamais, les réalités latino-américaines montrent la turbulence des sociétés et de l’ensemble des forces politiques : une situation dans laquelle l’extrême droite « libertarienne » et « anarcho-capitaliste » est capable de faire un ratissage électoral dans des secteurs populaires précaires, alors que dans le même temps, des courants politiques émergeant du cœur de la gauche incarnent des pratiques autoritaires ou sont déconnectés des mouvements sociaux, féministes ou écologistes. C’est ce que confirment plusieurs chapitres du livre et ce que souligne Daniel Kersffeld, rappelant que le progressisme a été marqué ces dernières années par diverses formes de caudillisme, de corruption, d’acceptation d’un modèle de développement extractiviste, ou encore par la mise en œuvre de politiques de « main de fer » et de militarisation, qui semblaient jusqu’à récemment être le « patrimoine politique » de la droite. Dans un autre chapitre, la chercheuse et militante féministe antiraciste Alina Herrera Fuentes souligne que le conservatisme patriarcal ne vient pas seulement des rangs de la droite :
« Les parcours nationaux des progressistes ont été et sont profondément fragiles et discontinus. À certaines périodes et sur certaines questions, des progrès ont pu être accomplis, mais ils se sont arrêtés à d’autres moments. Par exemple, alors que le taux de pauvreté global a diminué, la féminisation de la pauvreté a augmenté au cours de cette période. En d’autres termes, la pauvreté a globalement diminué, mais les femmes ont moins bénéficié que les hommes des politiques qui ont permis d’atteindre cet objectif (ONU Femmes 2017). Mais surtout, ce sont les politiques qui remettent en cause les normes traditionnelles de la famille et de la sexualité - comme l’avortement, le mariage homosexuel, la reconnaissance de l’identité de genre et, dans certains cas, la violence fondée sur le genre - qui ont été le plus entravées par le conservatisme des dirigeants ou directement par les alliances entre les hommes politiques au pouvoir et le néoconservatisme religieux en expansion. Les preuves à cet égard infirment l’hypothèse selon laquelle, par définition, la politique de gauche remet en question les croyances et les hiérarchies conservatrices, avec une base religieuse implicite ou explicite ».
Bien entendu, ces observations n’effacent pas le bilan positif des années 2000-2010 en termes de lutte contre la pauvreté, de progrès des politiques publiques en matière d’éducation, de santé ou de construction de logements, de conquête de processus constituants originaux (Bolivie, Équateur, Venezuela), l’élan bolivarien pour une intégration régionale indépendante des Etats-Unis (UNASUR, CELAC, ALBA), le développement d’une nouvelle diplomatie Sud-Sud, notamment grâce à Hugo Chávez, qui a tenté de privilégier un axe de gauche anti-impérialiste, et dans une certaine mesure à Lula, qui a favorisé l’accroissement de l’influence de son pays dans la région et l’axe des BRICS. En ce qui concerne les politiques internationales de Lula et de Dilma Rousseff, il serait utile de prendre en compte et d’actualiser l’analyse faite par l’auteur marxiste brésilien Ruy Mauro Marini (1932-1997) dans les années 1960, lorsqu’il a qualifié le Brésil de « sous-impérialisme ». Comme le note Claudio Katz :
« Ruy Mauro Marini ne s’est pas contenté de ressasser les vieilles dénonciations du rôle oppressif des États-Unis. Il a plutôt introduit le concept controversé de »sous-impérialisme« pour décrire la nouvelle stratégie de la classe dirigeante brésilienne. Il a décrit les tendances expansionnistes des grandes entreprises affectées par l’étroitesse du marché intérieur et a perçu leur promotion de politiques étatiques agressives pour faire des incursions dans les économies voisines ».7
Alors qu’Hugo Chávez soutenait activement le projet ALBA avec Cuba, avec l’appui notamment de la Bolivie et de l’Équateur, et jetait les bases d’une Banque du Sud, Lula a donné la priorité au renforcement du rôle régional et international du Brésil en tant que puissance régionale, coordonnant l’intervention militaire en Haïti (ce qui convenait parfaitement à Washington) et participant activement au lancement des BRICS en 2009 avec la Russie, la Chine et l’Inde (auxquels s’est ajoutée l’Afrique du Sud en 2011). Hugo Chávez avait besoin de la protection du Brésil de Lula contre le danger posé par Washington, et espérait beaucoup de son soutien à la création de la Banque du Sud. Bien que l’acte fondateur de la Banque ait été signé à Buenos Aires - en décembre 2007 - par les présidents brésilien Lula, argentin Néstor Kirchner, bolivien Evo Morales, vénézuélien Hugo Chávez et paraguayen Nicanor Duarte Fruto, le Brésil a effectivement paralysé la mise en œuvre de la Banque8 . La Banque du Sud n’a jamais fonctionné9 et aucun crédit n’a été accordé au cours des quinze années qui ont suivi sa création. En fait, Lula a favorisé l’utilisation de la Banque Nationale de Développement Économique et Social (BNDES) pour la politique de crédit dans la région. Cette banque accorde des crédits à de grandes entreprises brésiliennes comme Odebrecht, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. afin qu’elles puissent étendre et renforcer leurs activités à l’étranger10 . Par la suite, Lula a soutenu le lancement des activités de la Nouvelle Banque de Développement (NBD) créée par les BRICS, basée à Shanghai et présidée à partir de 2023 par Dilma Rousseff11 . Lula a également favorisé le Mercosur, qui correspondait aux intérêts du grand capital brésilien. L’avortement de la Banque du Sud doit être inclus dans l’évaluation critique de la première vague du progressisme. De même que l’isolement relatif de l’Équateur en 2007-2009 dans sa décision d’auditer sa dette et de suspendre le paiement d’une grande partie de celle-ci, en la déclarant illégitime. L’Équateur a remporté une victoire éclatante contre ses créanciers privés, mais son exemple n’a pas été suivi par les autres pays de la région, malgré les promesses faites lors de la réunion des chefs d’État de la région qui s’est tenue au Venezuela en juillet 2008, et contre la volonté du président Fernando Lugo (Paraguay) de suivre l’exemple de l’Équateur12 .
Ainsi, à l’heure du bilan, on perçoit toutes les nuances, les revers et les limites de ce premier cycle, tributaire d’équilibres fragiles et transitoires, qui a laissé place à une recomposition de la droite et même à des figures fascisantes (Bolsonaro, Kast, Milei, Añez, Bukele, etc.). En fait, si ce livre parle de « gauches et de droites » au pluriel, il explore aussi la notion même de « progressisme ». Cette caractérisation est présente dans presque tous les chapitres, mais que signifie aujourd’hui le progressisme latino-américain : la crise du processus bolivarien au Venezuela, les timides réformes du jeune président Boric au Chili, le « populisme de gauche » d’AMLO ? Ce mot est par excellence conceptuellement vaste et ambigu, devenant un mot insaisissable et en même temps omniprésent. En fait, il est intéressant de rappeler que « cette notion de progressisme appartient au langage par lequel, historiquement, la gauche marxiste a désigné les programmes et les forces sociales et politiques sociaux-démocrates, populistes ou nationaux-populistes qui cherchaient à transformer et à réformer le capitalisme en introduisant des doses d’intervention et de régulation de l’État et de redistribution des richesses : dans le cas de l’Amérique latine, avec un net accent anti-impérialiste et développementaliste. Ce dernier aspect, aujourd’hui présenté comme le »néo-développementalisme« , est lié à la notion de progrès et contribue à définir l’horizon et le caractère du projet, ainsi que les critiques qui, à partir de perspectives environnementalistes, écosocialistes ou postcoloniales, remettent en question l’idée de progrès et de développement, tant dans leurs expressions au cours des siècles passés que dans leur prolongement au XXIe siècle ».13
Nous pensons que ce livre montre que des ambiguïtés et des points de fuite peuvent également être trouvés lorsqu’il s’agit de définir les droits du temps présent, le conservatisme ou même la nouvelle extrême-droite. Cependant, ce que les cas de l’Équateur analysé par Franklin Ramírez Gallegos, du Brésil présenté par Luiz Bernardo Pericás et du Pérou (article de Damian A. Gonzales Escudero) soulignent, c’est qu’une base commune pour la consolidation et la radicalisation de la droite actuelle est la confrontation frontale avec le progressisme, que ce soit dans ses aspects nationaux-populaires ou de centre-gauche. C’est ce que confirme un pays, aujourd’hui scénario capital de la réaction continentale : l’Argentine, où la construction de la candidature « outsider » de Milei s’est appuyée sur la haine d’une partie de l’électorat pour le péronisme et le kirchnerisme, dans un contexte d’effondrement économique, d’hyperinflation et de rejet de l’administration d’Alberto Fernández, qui n’a pas tenu ses promesses de dénoncer la dette illégitime et odieuse contractée par Mauricio Macri auprès du FMI en 2018. Un autre pays qu’il serait intéressant d’inclure dans les réflexions est le Nicaragua de Daniel Ortega, car il offre l’exemple dramatique d’un pays gouverné par une force politique initialement issue d’une révolution (1979-1989) et qui incarne aujourd’hui la tutelle d’un clan familial répressif, qui a voulu mettre en œuvre un programme du FMI en 2018, provoquant une rébellion massive de la jeunesse et d’autres secteurs populaires, et qui a décidé de la réprimer brutalement afin de rester au pouvoir14 .
Il faut ici reconnaître un autre aspect original de ce livre : il inclut une réflexion sur la situation à Cuba, une réflexion critique nécessaire quand Cuba et sa révolution ont été un « phare » central de l’imaginaire de la gauche latino-américaine et mondiale tout au long du vingtième siècle15 . Manuel R. Gómez revient sur l’histoire de la droite cubaine, en tant qu’instrument « utile » - mais non décisif - de la politique étatique et impériale des Etats-Unis, tant dans les périodes de « main de fer » de Washington à l’égard de l’île caribéenne, que de rapprochement relatif et timide sous le mandat Obama. Quant à Wilder Pérez Varona, il pose à juste titre la question suivante : dans quel sens peut-on parler de gauche et de droite à Cuba aujourd’hui, compte tenu des spécificités de l’histoire cubaine depuis 1959 et de son régime sociopolitique ? Là, le terme même de « révolution » est devenu flou, car « pendant des décennies, le terme révolutionnaire a fusionné des relations très diverses. Très tôt, cette condition a expulsé toute opposition de la communauté politique nationale et l’a qualifiée de contre-révolutionnaire. L’utilisation du terme »révolution« a servi à synthétiser une épopée exceptionnelle, dont les réalisations et les acquis ont résisté à la belligérance systématique des États-Unis. Son utilisation a souvent évité à la fois l’analyse des contradictions du processus et de ses acteurs. La prémisse de l’unité face au siège a externalisé le conflit politique ».
Parler aujourd’hui, à Cuba, en termes de gauche/droite renvoie en fait à une question essentielle : celle de la représentation politique ou plutôt de son déficit, dans le contexte d’une société de plus en plus inégalitaire et différenciée, de l’élargissement de la contestation et des exigences croissantes de changements dans les domaines économique et culturel, mais aussi d’une véritable démocratisation politique.
Pour conclure cette brève présentation, revenons à notre constat initial. La « polycrise » mondiale et la prise de conscience que nous entrons dans une période de fortes turbulences qui se font sentir sur l’ensemble du continent. Ainsi, comme l’affirment Gabriel Vommaro et Gabriel Kessler, aujourd’hui « la polarisation idéologique avec des composantes affectives, le mécontentement généralisé et la polarisation autour d’un leader émergent marquent la politique latino-américaine, dont les électorats, comme sous d’autres latitudes, sont de plus en plus volatiles et insatisfaits »16 . Peut-être avons-nous là une leçon essentielle de ce livre collectif et des urgences qu’il signifie. Au-delà des régimes politiques, de droite comme de gauche, progressistes ou conservateurs, le malaise citoyen et le mécontentement de ceux « d’en bas » s’amplifient. Mais il y a aussi du désespoir si des alternatives démocratiques locales et globales n’émergent pas, un désespoir qui pourrait ouvrir la porte à des forces de plus en plus violentes et réactionnaires, et même à la possibilité du fascisme17 .
Depuis l’œil du cyclone, les auteur.e.s de cet ouvrage contribuent à l’analyse du moment crucial que nous vivons, à une meilleure compréhension du présent et à l’esquisse de perspectives d’avenir pour l’Amérique latine et les Caraïbes.
Traduit de l’espagnol par Christian Dubucq. Publié par le CADTM.
- 1Andreas Malm, Corona, Climate, Chronic Emergency, War Communism in the Twenty-First Century, Londres, Verso, 2020.
- 2Voir par exemple Tariq Ali, Piratas del Caribe. El eje de la esperanza, Madrid, Foca ediciones, 2008.
- 3 gobiernos progresistas, extractivismo, y movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, Edhasa, 2017 et Massimo Modonesi, « La normalización de los progresismos latinoamericanos », Jacobín América Latina, juillet 2022, jacobinlat.com/2022/07/04/la-normalizacion-de-los-progresismos-latinoamericanos.
- 4Pablo Stefanoni, La rébellion est-elle passée à droite ? Paris, Éditions La Découverte, 2022. Miguel Urban, Trumpismos, Neoliberales y Autoritarios. Radiografía de la derecha radical, Madrid, Verso, 2024, versolibros.com/products/trumpismos.
- 5Norberto Bobbio, Droite et gauche, essai sur une distinction politique, Seuil, Paris, 1996
- 6Temas, N° 108-109, marzo-octubre 2022, temas.cult.cu/revista/revista_datos/3
- 7Claudio Katz, La teoría de la dependencia cincuenta años después, Argentine, Ed. Batalla de Ideas, 2018, p. 102.
- 8Éric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, Paris, 2008, CADTM/Syllepse.
- 9Éric Toussaint, La banque du Sud est une alternative, pas celle des BRICS, CADTM, 19 août 2014. Voir également Éric Toussaint, « L’expérience interrompue de la Banque du Sud en Amérique latine et ce qui aurait pu être mis en place comme politiques alternatives au niveau du continent », www.cadtm.org/L-experience-interrompue-de-la-Banque-du-Sud-en-Amerique-latine-et-ce-qui , CADTM, 10 mai 2024.
- 10Caio Bugiato, « A política de financiamento do BNDES e a burguesia brasileira », in Cadernos do Desenvolvimento, www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/125/128
- 11Éric Toussaint, « Les BRICS et leur Nouvelle banque de développement offrent-ils des alternatives à la Banque mondiale, au FMI et aux politiques promues par les puissances impérialistes traditionnelles ? », CADTM, 22 avril 2024.
- 12Éric Toussaint et Benjamin Lemoine, « En Équateur, des espoirs déçus à la réussite. Les exemples de l’Afrique du Sud, du Brésil, du Paraguay et de l’Équateur », CADTM, 3 août 2016.
- 13Franck Gaudichaud, Massimo Modonesi, Jeffery Webber, Fin de partie. Les expériences progressistes dans l’impasse, (1998-2019), Paris, 2020, Syllepse.
- 14Nathan Legrand, Éric Toussaint, « Nicaragua, la otra revolución traicionada », CADTM, 30 janvier 2019, www.cadtm.org/Nicaragua-la-otra-revolucion-traicionada. Éric Toussaint, « Nicaragua, L’évolution du régime du président Daniel Ortega depuis 2007 », www.cadtm.org/Nicaragua-L-evolution-du-regime-du-president-Daniel-Ortega-depuis-2007 , CADTM, 25 juillet 2018. Éric Toussaint, « Nicaragua : Poursuite des réflexions sur l’expérience sandiniste des années 1980-1990 afin de comprendre le régime de Daniel Ortega et de Rosario Murillo », www.cadtm.org/Nicaragua-Poursuite-des-reflexions-sur-l-experience-sandiniste-des-annees-1980, CADTM, 12 août 2018.
- 15Tanya Harmer, Alberto Martín Álvarez (dir.), Toward a Global History of Latin America’s Revolutionary Left, Gainesville, University of Florida Press, 2021.
- 16Dossier « Cómo se organiza el descontento en América Laina ? Polarización, malestar y liderazgos divisivos », Nueva Sociedad, Nº 310, mars-avril 2024, nuso.org/articulo/310-como-se-organiza-el-descontento-en-america-latina/
- 17Dossier « Ultraderechas, neofascismo o postfascismo », Cuadernos de Herramienta, avril 2024, herramienta.com.ar/cuadernos-de-herramienta-las-ultraderechas-neofascismo-o-postfascismo